Des valeurs patriotiques dans l'esprit des jeunes. Le problème de la formation des valeurs patriotiques dans la conscience de masse de la jeunesse russe Vladimir Kirnitsky
À uniformes Les troupes de l'époque ont complètement oublié le but principal de l'habillement d'un soldat : le mettre à l'abri des intempéries, préserver sa force et sa santé, lui permettre de se déplacer confortablement et d'utiliser commodément les armes. Aucune de ces conditions tenue nos troupes n'étaient pas satisfaites. Dans les formes vestimentaires, un seul objectif était poursuivi - l'apparence formidable de l'ensemble du système et l'apparence guerrière et belle de chaque guerrier, pris individuellement. Par conséquent, les troupes se sont habillées d'articles extrêmement inconfortables et pour la plupart non seulement inutiles pendant la guerre, mais même nuisibles.
Cependant, une telle vision de tenue et équipement un soldat n'était pas la propriété exclusive de notre armée d'alors. Ce n'est que bien plus tard Guerre de Crimée, au début des années soixante, sous l'influence des expériences du ministère français de la guerre, la question de la conformité de la charge d'un soldat à ses forces et de l'hygiène de son uniforme commença à acquérir partout les droits de citoyenneté.

Notre armée avant Guerre de Criméeétait vêtu comme suit : uniformes étroits, avec une interception à la taille, à double boutonnage, à revers pour les gardes et les lanciers, et à simple boutonnage pour le reste ; ils n'étaient qu'à la taille, avec des pans de manteau à l'arrière; les manches sont étroites, avec une interception au poignet ; les cols sont hauts, debout, sans découpe devant ; ils étaient attachés au sommet avec des crochets et, serrant étroitement le cou, forçaient la tête à rester immobile. Dans les régiments de hussards, il y avait des dolmans, des mentics, des vestes et des hongrois, avec des harnais sur la poitrine. Dans les troupes Corps du Caucase les uniformes étaient avec des queues tout autour. Bloomers, drap l'hiver et lin l'été ; dans les leggings moulants de la cavalerie. Les bloomers, sauf pour la randonnée, étaient toujours portés lâches. Les pardessus sont longs, à simple boutonnage, avec un col montant, cousus à la taille, ajustés, de sorte que sous le pardessus, à l'exception de l'uniforme, rien ne puisse être enlevé. À la campagne, les planchers des capotes étaient pliés à hauteur des genoux pour plus de commodité, et parfois leurs coins étaient tournés vers les côtés et attachés à la taille, ouvrant ainsi les jambes presque jusqu'à la taille.
soldat tissu uniforme il était épais, non pelucheux, de couleur noire, de qualité très similaire au tissu de pardessus actuel. La qualité du tissu de pardessus de cette époque ne peut être jugée que par le fait que le pardessus, qui pesait généralement environ 8½ livres, pesait jusqu'à 23 livres après la pluie.
Chapeaux la plupart des troupes se composaient de casques en cuir verni noir, avec deux visières, des écailles assorties, un grand blason et de nombreuses décorations en cuivre. Les casques pesaient plus de deux livres, ligotaient le soldat et l'immobilisaient ; chauffés par le soleil, ils provoquaient des maux de tête et gênaient le tir. Leurs décorations en cuivre rendaient les troupes visibles de loin. Ce couvre-chef était si timide qu'au début de la guerre il était permis de les jeter en campagne et de se limiter à seulement casquettes, similaires à celles actuelles, qui en temps ordinaire étaient destinées à un usage domestique. Les hussards portaient des coiffes hautes shaco, en forme de cônes tronqués à base large vers le haut ; Les lanciers avaient un shako de même hauteur, mais avec une interception dans la partie médiane et avec un sommet quadrangulaire. Les chapeaux hauts de la cavalerie étaient également lourds et rendaient difficile, en particulier pour les dragons, de retirer leurs armes de leur dos. Selon les contemporains, la meilleure coiffure était le lancier. Les troupes caucasiennes au lieu de casques avaient des chapeaux ronds bas en peau de mouton avec un dessus en tissu.
L'inconvénient d'exister couvre-chef, cependant, a également été reconnu par notre administration militaire, qui cherchait les meilleurs modèles pour les introduire dans l'armée.
Archives du bureau. Militaire min. 1854, art. d. N° 150.
Viskovatov. Est la description une. et vor. Ross, troupes, éd. 1862
Militaire le recueil 1862, n° 3.
Archives du bureau. Militaire min., 1855, secret. d. N° 9.
Archives militaires. euh. com. Ch. pièces, sep. 2, d. n° 4328. Lettre aux militaires. min. Prince Menchikov 6 octobre 1854
Littérature:
Guerre d'Orient 1853-1856. op. Général d'Infanterie A.M. Zayonchkovsky. Chapitre 11
"La guerre d'Orient de 1853-1856 : l'uniforme de l'armée française à la différence des Russes (hors Corps séparés du Caucase) et des Britanniques..."
-- [ Page 1 ] --
Guerre d'Orient 1853-1856 :
Uniforme de l'armée française
Contrairement aux Russes (à l'exclusion du Corps Caucasien Séparé) et aux Britanniques
uniforme militaire, uniformes de l'armée française parmi tous les participants à la Crimée
la guerre, peut-être, était la plus adaptée aux opérations militaires, dans lesquelles, sans aucun doute,
l'influence fructueuse de la tradition de nombreuses années de campagne à Alger doit être considérée.
De plus, les Français (rappelant probablement les gelées de la guerre de 1812 en temps opportun) se sont bien préparés pour la campagne, non seulement en organisant un service médical adéquat, mais en fournissant également à leurs troupes des tentes et des uniformes d'hiver.
E. Nolan remarque : « Les Français se sont préparés à temps pour l'hiver. Des manteaux avec des capuchons sont arrivés [c.-à-d. n.m. « Pardessus de Crimée »], qui ravit les soldats ; et ces excentriques fils de Mars, les Zouaves, ont l'air encore plus excentriques dans ce nouvel habit. Des vestes en peau de mouton de style tartare [manteaux courts de fourrure] ont également été distribuées à partir des stocks français d'uniformes, qui sont devenus une source de confort pour les porteurs et de divertissement pour les observateurs. De plus, les Français ("avec l'ingéniosité innée d'un soldat français") n'ont pas hésité à améliorer et à reconstituer leur garde-robe, déshabillant leurs propres morts, alliés et ennemis. Les couvertures et les pardessus russes, les manteaux en peau de mouton et, bien sûr, les bottes étaient particulièrement appréciés. Néanmoins, les Français se sont longtemps souvenus de l'hiver de Crimée, et beaucoup l'ont comparé (à peine mérité, cependant) "avec la retraite de Moscou". "Cependant..., à quarante ans, la formidable leçon n'était pas perdue - tout le monde se souvenait de notre hiver en colère."
Les Français eux-mêmes, d'ailleurs, étaient plutôt sceptiques quant à l'état de leur service d'approvisionnement. Quelques années plus tard, Napoléon III déclare : « En France, ils ne sont jamais prêts à se battre. (L'empereur s'est avéré être un prophète - cependant, il pouvait se consoler du fait que son pays ne faisait pas exception.) Cela suggère que l'apparition d'un soldat en campagne était caractérisée par l'absence de ce qu'il aurait théoriquement dû être. donnée lors du départ pour le théâtre d'opérations. Ainsi, en mai 1854, le maréchal Saint-Arnaud, confirmant et développant effectivement l'idée (non encore exprimée) de son monarque, écrit : « Ils ne se battent pas sans pain, sans souliers, sans marmites et sans flacons ; Il me restait 40 pots et environ 250 flacons.
Général 1 Maréchal A.-J. Leroy de Saint-Arnaud, selon la coutume acquise en Algérie, portait un "fesi" - une casquette ordinaire, mais sans visière. (Certains échantillons, cependant, ressemblaient au chapeau de fourrage britannique Kilmarnock.) Couronne et bas en velours rouge, bande
- Velours bleu foncé. Le grade est facilement reconnaissable par neuf lacets dorés horizontaux, autour de la partie supérieure de la bande, et cinq verticaux, sur la couronne - deux de plus que ceux d'un général de division. En bas, il y a un nœud hongrois de trois cordes. Pélissier (photographié le 7 juin 1855), le nouveau commandant de l'armée de l'Est, portait le "fesi" de général de division, avec sept galons.
Sur la division (à partir de juin 1855) le général J.-E. de la Motterouge, lors de l'assaut sur Malakhov Kurgan, il y avait des casquettes de général de brigade (une rangée de couture, 25 mm de large) avec une mentonnière et un semi-caftan de tous les jours du modèle 1847 sans couture. Demi-caftan L'uniforme du général réglementé ne différait pratiquement pas de celui décrit précédemment pour 1870. Seul l'uniforme pendant la guerre de Crimée était encore cousu de tissu bleu foncé et non noir, et le col (hauteur moyenne 60 mm) était avec une découpe de 70 mm à l'avant. Les maréchaux étaient cousus sur le bonnet et le col de l'uniforme en trois rangées de 17, 10 et 8 mm de large. La hauteur du chapeau était alors de 140 mm à l'avant et de 205 mm à l'arrière. Le sabre du modèle 1844, utilisé pendant la guerre, était décoré sur la jante d'étoiles selon le rang ; la longe était une épée, mais avec une tresse de soie noire.
fermé par neuf gros boutons d'uniforme et avait des contre-épaulettes comme sur un uniforme. Les poignets étaient droits (comme ici) ou, plus rarement, avec un orteil. Ce demi-caftan servait d'uniforme de marche aux maréchaux et généraux du Second Empire. Sur l'uniforme de Motterouge, il y a des épaulettes et une ceinture de ceinture non standard d'une épée (couverte de dentelle d'or avec des lacunes cramoisies) avec un fermoir en forme de S entre deux médaillons (avec une tête convexe de Méduse).
Sur la photographie de Roger Fenton 2 (n° 207), le chef d'état-major de Bosquet, le général Cissé, est représenté coiffé d'une casquette (apparemment avec un galon solide très large sur le haut de la bande), un semi-caftan toute la journée (boutonné d'un seul bouton) avec une aiguillette et des épaulettes, un gilet droit (avec des boutons) et un pantalon bouffant ample avec une rayure.
Bosquet lui-même (photo n ° 258) est vêtu du même semi-caftan de tous les jours avec des épaulettes (mais avec trois boutons aux poignets au lieu de deux) sur un gilet avec une ceinture noire (avec un fermoir en forme de S). Casquette de général - avec trois galons sur la couronne, un nœud hongrois sur le bas et une couture de général sur la bande. Pantalon, curieusement, de couleur uniforme avec passepoil rouge. Sur d'autres photos (nos. 81x et 119), Bosque donne des ordres à son état-major - le général porte le même uniforme que sur l'image précédente, et il est chaussé de cuissardes en cuir noir à éperons. Posant pour un photographe à cheval sur Bayard (n° 278), avec un tapis de selle et des lingots (en fourrure de léopard), Bosquet enfila un chapeau de costume à galon et se ceignit d'un ceinturon d'épée de galon avec une longue épée droite.
Le général d'Hautmar (commandant de la 1re division du 1er corps) au printemps 1856 portait « une petite barbe. Il était en fait déformé : l'uniforme exigeait une barbiche 3, pas une barbe ; mais en Crimée, qui pensait aux formes ? Il portait une redingote à simple boutonnage avec des épaulettes, qui avait un champ brodé, avec trois grandes étoiles, ce qui signifiait un général de division. … Le col était également cousu. Le chef d'état-major de Pélissier, général de division de Martimpre, portait « une redingote à épaulettes et à aiguillette, comme tous ceux qui sont au quartier général ».
« Officiers, en redingotes ou en vestes [noires] cousues de lacets. Ces vestes sont adoptées par le quartier général et forment une sorte d'uniforme. Ils ne sont cependant portés que par de jeunes officiers, ressemblant alors à des hussards. Un « pardessus de Crimée » bleu pouvait être jeté par-dessus la veste. Le reste des officiers de l'état-major général étaient "en redingote à épaulettes et en pantalon rouge inchangé à bande noire, ce qui signifiait appartenir à l'état-major général".
La coiffure du corps d'état-major était un képi avec une couronne framboise, une bande bleu foncé, une fausse sangle dorée, un nœud hongrois sur le bas et avec des galons par rang.
Arrêté de la Garde Impériale du 1er mai 1854 "La Garde Impériale est en cours de restauration." Parmi les soldats des compagnies d'élite attribuées par chaque régiment linéaire, deux régiments de grenadiers et deux de voltiger ont été formés. Leur composition fut répartie en trois bataillons de 8 compagnies chacun (le 17 février de l'année suivante, le nombre de bataillons fut porté à quatre). Et déjà fin janvier 1855, la brigade temporaire des gardes (1er bataillons des quatre régiments d'infanterie) débarque en Crimée. Pour le mois de mars, le contingent des Gardes comprenait également 4 compagnies de rangers et 2 bataillons de zouaves, ainsi que 2 batteries à cheval et une compagnie du génie.
Le 18 mai, une nouvelle brigade les a rejoints près de Sébastopol, à la suite de quoi la division des gardes a été créée:
Tous datent de 1855.
Au contraire, le maréchal Pélissier était « avec une petite moustache grise et le même bouc », coiffé d'un « chapeau d'apparat recouvert d'un plumet blanc » pour visiter le camp russe le 1er (13) avril 1856.
1ère brigade: un bataillon de rangers à pied, trois bataillons chacun des 1er et 2e régiments de Voltiger.
2e Brigade : Régiment de Zouaves, trois bataillons chacun des 1er et 2e Régiments de Grenadiers.
Régiment de gendarmerie à pied (2 bataillons), 4 (1ère, 2ème, 7ème bis et 8ème bis) batteries à pied et 4 (1, 2, 3 et 4ème) montées (Guards Horse Artillery Regiment), compagnie du génie, compagnie de convoi.
1ère brigade : Zuavsky, 1er et 2e régiments de Voltiger.
2e brigade : bataillon Foot Jaeger, 1er et 2e régiments de grenadiers.
1ère et 2ème batteries d'artillerie à pied. Au total, 4 batteries du Guards Foot Artillery Regiment ont opéré en Crimée.
Compagnie d'ingénierie des gardes (parfois appelée 1ère garde).
Les gardes ont passé près d'un an en Crimée - ses premières unités ont quitté la capitale en janvier 1855 et le 29 décembre de la même année, tous les vétérans de Crimée sont entrés à Paris.
Napoléon n'a pas osé envoyer la cavalerie des gardes en Crimée. Le régiment des Guides, il est vrai, devait y accompagner l'Empereur (mars 1855), mais la visite n'ayant pas eu lieu, les Guides restèrent en France. Cependant, le régiment de Horse Rangers a été formé (par décret du 20 décembre 1855) et a été formé précisément en Crimée. Il se composait de 4 escadrons de la cavalerie légère de l'armée de l'Est et de 2 escadrons du 4e régiment aboli des chasseurs d'Afrique. (L'uniforme des Chasseurs ne différait pratiquement pas de celui décrit pour 1870.) Dans le même temps, les trois premiers bataillons de chacun des nouveaux régiments d'infanterie de la garde ont été créés en Crimée - le 3e Grenadier et les 3e et 4e Voltigers.
Le décret instituant la Garde (1er mai 1854) est suivi d'une description de son uniforme publiée le 19 juin. Ses auteurs se sont inspirés des traditions impériales de Napoléon Ier, préférant le frac et les bretelles au demi-caftan et à la ceinture introduits dans l'armée neuf ans plus tôt. Il est intéressant qu'un tel désir d'archaïsme et une tendance à préserver les traditions aient joué un tour cruel aux Français de Crimée. Le fait est que lorsque l'infanterie de la garde a été amenée au combat près de Sébastopol et, après avoir échoué, s'est repliée sur ses positions, la réserve française a ouvert le feu sur les gardes, les prenant "pour des bandages blancs pour des mousquetaires russes".
De plus, « ils disent que les nôtres, s'étant approchés assez près des gardes et remarquant les bandages blancs, que les Français n'ont pas encore vus, leur ont crié : « Qui êtes-vous, les nôtres ou quoi ? Parle ou on tire !" De là, ils ont répondu en russe pas tout à fait proprement :
le nôtre, le nôtre ! – et puis déjà Podoltsy est allé aux baïonnettes ». "Invalide russe" du 18 juin 1855 (n ° 133) a réimprimé le message du journal "L" etoile Belge "que de nombreux gardes français, grâce à leurs ceintures blanches, qui se détachent nettement sur le fond des pardessus sombres et des ceintures noires d'autres fantassins, sont devenus légers une cible pour les tireurs russes. Par conséquent, il a été jugé nécessaire de se débarrasser des bandages perfides et de les fabriquer désormais à partir de simples ceintures ou cordes.
Il convient également de prendre en compte que déjà en 1856-1857. l'uniforme de l'infanterie de la garde a subi certaines modifications, dont les auteurs ne tiennent pas toujours compte lorsqu'ils décrivent son apparition en Crimée. Les grenadiers en 1854 ont reçu un chapeau sous la forme d'un cadre en cuir recouvert de fourrure d'ours noir. Dimensions chapeau : hauteur 30 cm, largeur 25 cm
- moins que son prédécesseur durant les années du Premier Empire. Le bas de drap écarlate, avec une grenade blanche brodée. Sur une plaque de cuivre, il y avait un aigle couronné convexe (sur un fond en forme de rayons de soleil), assis sur une grenade avec un numéro de régiment découpé dans une bombe. Mentonnière composée de 59 anneaux entrelacés sur une base en cuir. En tenue de soirée, une étiquette blanche était attachée au bonnet, retenu sur la coiffe avec un crochet en haut à droite et l'autre à gauche, à la base. Le sultan écarlate (hauteur 24 cm) était attaché à gauche, mais sous forme de marche, il a été retiré, ne laissant qu'une carte à pompons en laine.
Les Voltigeurs se contentaient d'un shako (hauteur 170 mm à l'avant et 200 mm à l'arrière), garni de drap bleu foncé. La dentelle autour du haut du shako et les doubles chevrons sur ses côtés étaient blancs, bien que même alors la couleur jaune, officiellement fixée pour la dentelle shako en 1857, pouvait être utilisée (on pense que déjà le 1er octobre 1854).
L'insigne en laiton ressemblait à la version de l'armée, un aigle couronné surmonté d'une grenade avec le numéro du régiment dans la bombe. La visière était gainée d'un rebord en cuivre. En grande tenue, une étiquette blanche était supposée, contrairement à un modèle similaire pour les grenadiers, plus étroit et équipé non pas d'une, mais de deux cutas, également plus petites. Hors service, la mentonnière écailleuse devait être relevée sur une cocarde de cuir ; la grenade était estampillée sur des rosaces dans un cor de chasse. Sur la mallette de camping du shako (faite de toile cirée noire avec une plaque arrière dépliante), il y avait un emblème similaire appliqué en peinture jaune. Le sultan jaune des voltigeurs pour les premiers (issus du shako) était constitué (à partir du 1er octobre 1854) de plumes écarlates, le pompon-« sphère » était jaune. En l'absence de sultan, un deuxième pompon, "sultan", également de teinte jaune (à l'époque de Crimée), a été ajouté.
Le bonnet de fourrage dans les gardes, contrairement à l'expérience de l'armée, est resté du même type - avec un chapeau. Ce bonnet était entièrement bleu foncé, avec un liseré de la calotte et une tresse écarlate/jaune de la bande. Un pompon de la même couleur distinctive pendait sur le devant.
Sur la bande grenade ou grenade dans la corne. La casquette de la Garde ne servait que de coiffe de travail non combattante, en Crimée, les grenadiers portaient des chapeaux de fourrure avec des plaques et les voltigeurs portaient des shakos dans un étui. Curieusement, les fantassins de la Garde glissèrent le bonnet de fourrage sous le pardessus, de manière à ce que son pompon ressorte lorsque le col était déboutonné.
Pour les officiers sur les coiffes, le fil blanc des étiquettes et des grenades a été remplacé par de l'or, et les galons et emblèmes sur le calot étaient en or. Le pompon de l'uniforme quotidien des officiers Voltiger ne différait pas de l'échantillon prévu pour les grades inférieurs, mais au quartier général, le «sultan» était blanc. Sur le boîtier du shako, la grenade dans la corne était dorée.
L'uniforme de coupe queue de pie bleu foncé comprenait un revers blanc (bleu foncé dans l'uniforme de tous les jours) (boutons 2x8), couvrant sept boutons en os noir, sur lesquels la planche était fixée. Le collier est bleu foncé (grenadiers) ou jaune (voltigeurs).
Les épaulettes et contre-épaulettes sont écarlates pour tous les régiments, mais les voltigeurs se distinguent par des demi-cercles jaunes.
(Pour les sous-officiers de tous les régiments du demi-cercle, les épaulettes étaient en or.) Les parements sont bleu foncé avec un liseré jaune, orteil (voltigeurs), ou écarlate, droit, avec des valves blanches à trois bras sur trois boutons chacune ( grenadiers). Planchers (plus longs que sur les uniformes d'artillerie et de cavalerie) avec revers écarlate/jaune avec grenade blanc/bleu marine. Les boutons de tous les régiments étaient en cuivre, avec un aigle couronné et la légende : « Garde impriale ». Les officiers ont des emblèmes sur les revers de la queue de pie et des contre-chauffeurs d'or, et l'uniforme lui-même est cousu de tissu fin.
Un pardessus servait de vêtement de voyage aux gardes en Crimée. Son apparence était très différente de la norme adoptée dans l'infanterie de l'armée - à la fois en couleur (bleu foncé au lieu de bleu-gris) et en coupe. La distance entre deux rangées de boutons uniformes (sept dans chacune) était de 170 mm en haut, 130 au niveau de la 4ème paire et 50 mm en bas. De plus, ce pardessus était coupé «à la taille» - seuls les sous-officiers en portaient dans l'armée.
Ainsi, à l'arrière de la taille, les habituelles pattes et rabats de poche à deux œillets ont cédé la place à deux rabats de poche à trois pointes à boutons.
Le col du pardessus (avec une découpe) et les poignets droits (avec une fente) étaient toujours de la couleur du pardessus lui-même, bien que formellement les voltigeurs devaient porter un col jaune et des passepoils aux poignets. Au niveau de la cuisse dans la capote, de chaque côté, une poche horizontale était découpée, recouverte de rabats - un fourreau de sabre était enfilé à gauche pour les rangs qui en étaient armés. Sur les manches du pardessus, des galons de grades en laine écarlate / jaune ou en or «à dents» (sous-officiers) étaient visibles. Les contre-épaulettes sont identiques à celles cousues sur l'uniforme. Les sous-officiers et les officiers portaient des contre-chauffeurs en or, qui étaient censés - avec une autorisation rouge.
Le képi et le « pardessus de Crimée » du colonel (général de brigade depuis le 11 août) L.-R. de Marol du 2e Régiment de Voltigeurs, tué le 8 septembre 1855 lors de l'assaut contre Malakhov Kurgan. Le pardessus qu'il portait le jour de sa mort est cousu de drap marron, garni de deux rangs de cinq boutons d'officier des gardes d'infanterie, et cinq galons de galon plat longent le haut des parements droits. (Au contraire, on ne sait rien du port d'un tel pardessus par des gardes ordinaires.) Une casquette non réglementée, également «de Crimée», en mince tissu bleu foncé avec une tresse dorée (comme insigne) et une fausse sangle. Exactement la même casquette était utilisée en Crimée par les officiers de l'artillerie des gardes.
La veste de la Garde, comme le pardessus, n'était pas équipée d'une valve pour maintenir la ceinture - faute d'une. Sinon, cela ressemblait à un motif militaire, avec des épaulettes et des rabats à trois pointes sur le col écarlate/jaune. Les poignets de toutes les étagères sont droits. Les pantalons, contrairement à la croyance populaire, en Crimée étaient bleu foncé avec une bordure écarlate / jaune, sans poches. La culotte rouge à passepoil bleu foncé ne fut introduite qu'en juillet 1856, après le retour des Gardes en France, bien que dans le 3e régiment de grenadiers (formé le 20 novembre 1855) pas mal de soldats portaient déjà des pantalons rouges avant de rejoindre le régiment. Soit dit en passant, les gardes eux-mêmes ont exprimé leur mécontentement à l'égard des pantalons bleus, estimant qu'ils leur donnent un aspect inutilement sombre et, en général, la Garde en conséquence "a l'air pâle devant les régiments de ligne". Par conséquent, la couleur du pantalon a été changée en rouge. Cependant, je le répète, cela s'est produit après l'arrivée des gardes de Crimée. Les guêtres et les chaussures étaient d'un modèle commun.
Les baudriers de la cartouchière et du sabre (largeur 70 mm) étaient taillés dans du cuir de bovin blanc, cousus sur les bords (distinction de la Garde). De plus, un sac capsule était attaché au premier bandage, et le sac lui-même était attaché à la ceinture avec deux boucles en cuivre placées en dessous. Le couvercle de la douille était orné d'un aigle couronné en cuivre (95x90 mm) et de quatre grenades/cornes aux angles, tournées par la bombe et les trous des cornes vers l'aigle. Dimensions sac : longueur totale 210 mm, longueur boîte 190 mm, largeur sac 55 mm, hauteur 110 mm. A l'arrière, une ceinture en cuir était cousue au sac (coupé en forme de grenade à l'extrémité, 120 mm de long), fermée par un bouton, également en cuir, sur une bretelle. Une couverture en lin blanc s'appuyait sur le sac, où l'aigle et les grenades/cornes étaient peintes en noir. Sur une autre bretelle, le garde portait deux fourreaux
- sabre et baïonnette. Les sous-officiers hors formation portaient un baudrier de sabre en tissu avec une lame en cuir laqué noir. La ceinture de fusil de la Garde était également en cuir blanc, cousue le long des bords. Sa longueur était de 93 cm pour les grenadiers et de 90 cm pour les voltigeurs.
Le sac à dos de l'infanterie des gardes ne différait du prototype de l'armée que par des lanières - en cuir blanc, mais non cousues et non bifurquées. La couverture de l'uniforme et du pardessus en teck rayé a toujours conservé des extrémités bleues avec une grenade (hauteur 60 mm) ou une corne écarlate/jaune. Un flacon (sur une ceinture blanche) avec un trou était gravé du numéro personnel du soldat et des emblèmes blancs / jaunes (grenade ou grenade dans une corne).
Armes : grenadier ou voltigeur fusil rayé de l'échantillon des gardes de 1854 (calibre 17,8 mm, longueur 1,475 m et 1,421 m, respectivement), sabre de fantassins de l'échantillon de 1831 et baïonnette de l'échantillon de 1847. Sapeurs : fusil rayé de gendarme de l'échantillon des gardes de 1854 ., hache, sabre et baïonnette. Batteurs : sabre ; leur caporal hors formation (et, apparemment, en campagne) portait un sabre du modèle 1854 pour sous-officiers de la garde (comme un sabre d'officier d'infanterie de 1821, mais sans dorure ni cordon). Les ajudans (avec lanière d'officier de tous les jours), les musiciens et le tambour-major (uniquement en uniforme de service ou de marche, dans d'autres cas - un sabre de 1822 avec une bordure dorée) étaient armés du même sabre. Officiers subalternes : sabre d'officiers d'infanterie, modèle 1845
(gaine, cependant, cuir noir, sans anneaux, à l'embouchure de la gaine il y a un crochet pour une fronde); lanière or ou soie noire. Officiers supérieurs : sabre d'officiers supérieurs d'infanterie 1845 (avec le même fourreau spécial).
L'uniforme de marche des sapeurs et des musiciens du régiment se présentait comme suit.
Tambourmajor : sur le col du pardessus il y a un double galon d'or, et sur les manches il y a des rayures d'un sergent supérieur. Épaulettes pour sous-officiers ; le long de la bandoulière au milieu, il y a une bande écarlate / jaune et des deux côtés une bande dorée, qui se poursuit sur le champ de l'épaulette; épaulette à franges mélangée de laine écarlate et de fil d'or. Bonnet en fourrure noire (hauteur 250 mm devant, 300 mm derrière et largeur 220 mm) du patron général, avec un pompon tricolore. Shlyk et Sultan ont été filmés. Caporal-tambour : galon tricolore au col du pardessus, sur les manches des galons du caporal. Epaulettes de tambour-major, mais frange écarlate. Contre-épaulettes de sous-officier. Casquette de dessin spécial (hauteur 220 mm à l'avant et 170 à l'arrière, largeur 20 mm) avec une cocarde à pompon tricolore. La ceinture de sabre est comme celle des soldats.
Le batteur:
sur le pardessus il y a un galon tricolore (collier), et des épaulettes à contre-épaulettes comme celles des soldats.
Bande tympanique en cuir blanc, cousue sur les bords, décorée (au-dessus du porte-bâton) d'une grenade/cornet de grenade. Tablier de toute l'armée, ceintures de tambour en cuir blanc cousues le long des bords. Le tambour lui-même est décoré de symboles de gardes - un aigle et des grenades / cornes avec une grenade. Musicien : un ou plusieurs galons d'or au col, selon le statut. (Il y avait trois classes au total pour 28 musiciens de la fanfare régimentaire, et la seconde, par exemple, portait une tresse de 22 mm de large et en dessous une tresse de 5 mm.) Épaulettes tambour-major, mais sans frange. Harnais d'épaule Sabre en tissu avec lame en cuir verni noir. Sur le boîtier de la cartouche, il y a un couvercle sans symboles, une bande laquée noire. Bonnet de caporal-tambour (grenadiers) ou shako (voltigeurs), avec un pompon écarlate et un "sultan" blanc. Démineur : un emblème était brodé sur les manches de la capote (deux haches croisées de couleur écarlate/jaune). Le caporal sapeur portait des galons de caporal.
Cartouchière et son baudrier (au-dessus du point de croisement des baudriers, orné d'un emblème en forme de mufle de lion) du modèle habituel. Sacoche de sapeur, avec un étui pour une hache. Dans tous les régiments, les sapeurs portaient un chapeau de fourrure sans insigne ni bas.
Le régiment des gardes zouaves a été formé le 23 décembre 1854 (deux bataillons de 7 compagnies chacun) à partir de distingués zouaves et rangers de l'armée. Le 14 janvier 1855, l'empereur adopte pour le régiment "une veste bleue à passepoil jaune, un pantalon rouge, un turban rouge, un fez bleu, des jambières comme le reste des Zouaves". Mais la description de l'uniforme n'est apparue que le 6 avril, et il y était déjà question "d'un turban blanc et d'un fez rouge". Ce texte a été publié le 19 avril, bien qu'il soit antidaté au 13 mars. Mais inutile de le raconter, puisque Vanson, étudiant l'apparence du régiment avant son départ de Crimée (novembre 1855), constate que presque tous les soldats portent encore l'uniforme des zouaves de l'armée.
Quatre compagnies du bataillon des gardes Jaeger (formé le 1er mai 1854) se rendirent en Crimée en janvier 1855 et furent rejointes par les quatre autres en mai.
Le règlement du 19 juin 1854 fixe les détails de l'apparence de l'ensemble. Le shako de l'échantillon des gardes voltigeurs, gainé de drap bleu foncé. Galon autour du haut de laine jaune. Les chevrons sur les côtés sont jaunes, 33 mm de large, avec un trou noir au milieu.
Cocarde en cuir 58 mm. Visière en cuir noir, dessous vert, sans doublure.
Jugulaire, largeur 20 mm, en cuir verni noir. Insigne (120x110 mm) avec un aigle couronné estampillé sur une bombe (avec un cor de chasse) et des éclairs. En grande tenue, le sultan « saule pleureur », noir et vert, avec un haut écarlate. En forme de tous les jours pompon sphérique vert, 55 mm. Couverture en toile cirée noire avec emblème peint en blanc (cor de chasse en bombe grenade). L'échantillon de képi de 1852 est bleu foncé, avec des lacets jaunes le long de toutes les coutures. Galon jaune (15 mm) sur une bande 3 mm au-dessus de la bordure à l'endroit où la bande était reliée à la couronne. Grenade (35 mm) est brodée de laine jaune sur la bande devant.
Uniforme bleu foncé, à 9 gros boutons (en métal blanc, avec un aigle couronné bombé entouré de la légende Garde impriale). Les jupes courtes ne mesurent que 150 mm de long, sur le pli du côté gauche il y a une fente (bordée de jaune) sous le rabat pour tenir la ceinture (également avec passepoil jaune). Col (hauteur 55 mm) avec passepoil jaune. Tant sur le col que sur les faux revers, il y a des grenades à moitié jaunes.
Sur le côté, le bas de l'uniforme, les poignets (orteil, hauteur totale 110 mm ; deux boutons sur la manche), les rabats de poche verticaux, les revers et, apparemment, les coutures des manches - passepoil jaune. Contre-épaulettes de galon vert à doublure bleue, épaulettes vertes à demi-cercles jaunes. La veste est bleu foncé, avec 9 petits boutons. Poignets à pointe, grenades jaunes au col, pas de boutons ni d'épaulettes aux épaules.
Pantalon en drap de fer gris foncé, « large, avec sept plis de chaque côté devant et six dans le dos. En longueur ils sont tels qu'après s'être ajustés autour de la cavité poplitée avec un ruban à bouton en os, ils tombent presque jusqu'aux genoux. Deux poches latérales (longueur 180 mm) étaient garnies de dentelle jaune. Le deuxième lacet était cousu en parallèle à 20 mm de chaque côté de la fente et se terminait en haut et en bas par un nœud hongrois. Le volume des pantalons (ou plutôt des pantalons étroits) était le même que ceux adoptés plus tard, en 1860, pour l'infanterie, mais inférieur aux spacieux pantalons "orientaux" des zouaves et des tireurs. Pantalons pour robes - en teck, coupe uniforme, mais plus long de 80 mm. Legging en cuir d'agneau rougeâtre, motif Zouave, lacé (avec six trous pour le lacet). Des leggings en toile ou en cuir d'un motif général étaient portés avec des leggings. Cape (« col à capuchon ») en drap de fer gris bleuté, à 4 petits boutons, longueur 80 cm devant, 100 cm derrière.
Ceinture (largeur 6 cm) en cuir noirci. Il avait une plaque en cuivre (avec une grenade convexe) et deux interceptions en cuivre pour les sangles du sac à dos. Cartouchière d'un échantillon d'infanterie de 1854 (longueur 210 mm, hauteur 130 mm), sur le couvercle il y a un aigle couronné en cuivre (hauteur 95 mm). Cartable Jaeger, veau noir. Couverture et extrémités de la veste en toile cirée noire (longueur 370 mm, 110 mm). Arme : carabine à tige modèle 1846 et 1853 (ceinture en cuir noir, longueur 90 cm), couperet baïonnette modèle 1842 dans la lame sur la ceinture ventrale.
L'insigne de grade est comme celui des chasseurs de l'armée : laine jaune ou (sous-officiers) argent avec bordures jaunes. Instructeurs de tir : galons d'un sergent, mais en métal renversé (or). Les chevrons de longue durée sont écarlates/argentés.
Sous-officiers :
les demi-cercles de l'épaulette sont tressés de fil d'argent, les contre-épaulettes sont galon d'argent avec une lumière rouge. Clairons : galon avec des losanges tricolores sur le col (la grenade est placée sur le galon) et les poignets de l'uniforme (mais pas la veste). Sous-officier clairon :
galons du grade, ainsi que deux galons d'argent (le premier de 22 mm de large ; le second de 10 mm, à une distance de 3 mm du premier) sur le col et les poignets de l'uniforme. Musiciens excités :
dentelle argentée sur le col et les poignets de l'uniforme. Corne avec un voile vert foncé.
Sapeurs : sur chaque manche un emblème (deux haches croisées sous une grenade), brodé en laine jaune (avec un uniforme) ou découpé en drap jaune (sur une veste).
Ajudans : demi-caftan d'officier. L'épaulette (sur l'épaule droite) et la contre-épaulette sont dorées, avec une bande rouge au milieu. Aglets avec des sections argentées de 60 mm de long, alternant avec des sections rouges, de 25 mm de long. Pantalon d'officier, mais uniquement avec passepoil jaune. "Sanglier" d'officier avec noeuds hongrois noirs.
Shako d'officier, galons d'argent à manques de soie rouge. Sultan des soldats, pompon en laine blanche. Le képi est aussi celui d'un officier, sans jugulaire, le lacet de la bande est argenté avec un jeu rouge, les lacets sont 2/3 argent et 1/3 rouge ; dentelle sur la visière. Harnais noir sous toutes ses formes. Sabre d'ajudans d'infanterie.
Les officiers en juin sont censés porter l'uniforme des soldats et le pantalon des officiers des rangers de l'armée. Le 25 novembre 1855, des semi-caftans leur sont installés. Cependant, étant donné que le bataillon était encore en route à ce moment-là, il est peu probable que l'un des officiers ait eu le temps de se coudre un nouvel uniforme avant d'arriver à Paris le 29 décembre.
L'uniforme du bataillon de rangers de la Garde en Crimée : « Les Jägers portent tous une barbe. (Ils) dans une veste sans épaulette. Sous-officiers dans un semi-caftan [c.-à-d. e. uniforme] sans épaulettes. Les leggings et leggings sont en toile. Pantalon en toile grise pour sous-officiers et soldats, habillé sur tissu. Petit flacon d'un nouveau design [rectangulaire, à deux trous].
Boucle de ceinture avec grenade. Sacs à dos noirs. Aigle sur cartouchière.
Shakos gainés, visière d'un shako d'infanterie, inachevé. Il n'y a pas d'emblèmes ou de chiffres sur les shakos [note intéressante !]. Pas de jugulaire. Un bonnet avec un lacet jaune au-dessus du liseré de la bande » (Vanson, 6 novembre 1855).
Les gendarmes à pied portaient des chapeaux de grenadier avec une plaque de cuivre et un sultan écarlate, un uniforme coupe queue de pie bleu foncé avec un revers écarlate (bleu foncé dans la forme de tous les jours), des boutons en étain et des aiguillettes et épaulettes blanches en forme de trèfle et bleu clair (plutôt d'apparence gris-bleu) pantalon . Le col est bleu foncé, avec une grenade blanche de chaque côté. La doublure de l'uniforme est écarlate, tout comme les revers de la queue (avec grenade blanche) et le liseré des parements et des valves de manchettes. Les pardessus sont bleu foncé, gardes. Équipement de l'échantillon Guards Grenadier, mais les ceintures (y compris la ceinture de mousquet et les ceintures du sac à dos) sont en daim jaune, avec une doublure de galon blanc le long des bords du baudrier. Seuls les gendarmes de la Garde avaient officiellement droit à des casquettes (modèle 1853) à visière rectangulaire, bande bleu foncé et couronne bleu clair. Sur le bonnet, les lacets (le long des coutures de la couronne et autour du bas et de la bande), la grenade et le galon étaient en fil blanc de 13 mm de large. Ce galon était cousu le long du bord supérieur de la bande sous la dentelle horizontale. Les brigadiers et sous-officiers étaient censés avoir un képi avec galon d'argent et grenade, le centre de la bombe était en laine bleue, et les lacets étaient faits d'un mélange d'argent (2/3) avec de la laine bleue (1/ 3). Les Ajudans portaient le képi de sous-lieutenant, avec une dentelle horizontale dorée. Les officiers ont reçu des casquettes avec des galons d'argent, une grenade et une fausse sangle. Au lieu de lacets, une tresse plate était cousue et il y avait un nœud hongrois en bas.
L'artillerie des gardes portait un bonnet noir en peau de phoque. Mentonnière avec écailles en laiton. Pendant la campagne, le sultan a été enlevé, ne laissant qu'un pompon écarlate.
Le dolman était fait de tissu bleu foncé, avec des cordons et une tresse écarlates, et avec trois (régiment à pied) ou cinq (régiment de cavalerie) rangées de boutons en laiton. Le col (bleu) et les manchettes (orteil, tissu écarlate) étaient gainés d'un galon de laine écarlate. Cependant, dans le régiment à pied, à l'origine (texte daté du 5 avril 1855), ils portaient un dolman d'artillerie à cheval, où les huit premières cordes de la poitrine étaient posées sur un morceau de tissu, formant une sorte de revers. Les pantalons des gardes étaient d'artillerie, bleu foncé avec des doubles rayures et des bordures écarlates, avec des leggings / bottes. Les artilleurs d'artillerie à pied portaient une ceinture blanche sous un dolman, portant une lame de sabre à gauche. Sur l'épaule gauche, ils ont mis une ceinture blanche d'un cartouchière noire. La sacoche était de type infanterie. Dans l'artillerie à cheval, une ceinture portée sous un dolman tenait un sabre et une tashka, et un baudrier tenait une petite grenouille.
Les ingénieurs de la garde différaient de ceux de l'armée par leur coiffure - un chapeau de fourrure noire sans insigne et une étiquette rouge. Sinon, leurs uniformes correspondaient aux unités du génie de l'armée, avec grenade écarlate / or sur le col de leur uniforme et avec la cartouchière des grenadiers de la garde. La taille minimale pour les ingénieurs de la Garde était de 1,68 m, à égalité avec le régiment des Guides, tandis que pour les grenadiers (« tout le monde est jeune et beau ») et canonniers, elle était de 1,76 m.
Infanterie linéaire et légère Les unités d'infanterie suivantes ont opéré en Crimée (en gras, la nouvelle numérotation des anciens régiments légers, devenus en octobre 1854, est surlignée en gras).
linéaire):
1 division (7e, 20e et 27e régiments de ligne). Parti pour la Crimée en avril 1854.
2 division (régiments de 50 lignes, 7 légers et 6 lignes). Parti pour la Crimée en avril 1854.
3 division (20 et 22 régiments légers). Parti pour la Crimée en avril 1854.
4e division (19e, 26e, 39e et 74e régiments de ligne). Parti pour la Crimée en avril 1854.
5 divisions (21 et 42 linéaires, 5 régiments légers et 46 linéaires). Parti pour la Crimée en juin 1854.
6 division (28 et 98 régiments). Parti pour la Crimée en octobre 1854.
Division de Salya (18e, 79e, 14e et 43e régiments). Parti pour la Crimée en décembre 1854.
Division Dulac (57e, 85e, 10e et 61e régiments). Parti pour la Crimée en décembre 1854.
Division Brunet (86, 100, 49 et 91 régiments). Parti pour la Crimée en janvier 1855.
Division Herbillon (47e, 52e, 62e et 73e régiments). Parti pour la Crimée en avril 1855.
Division d'Orelle de Paladin (9e, 32e, 15e et 96e régiments). Parti pour la Crimée en avril 1855.
Brigade de sel (30e, 35e et 94e régiments). Parti pour la Crimée en mai 1855.
Après la chute de Sébastopol, les 20e, 39e, 50e et 97e (ancien 22e léger) régiments sont rappelés en France et remplacés par les 64e, 11e et 31e (ainsi que le 35e - dans la brigade de Salt) régiments. Une autre division, la 12e, fut formée, composée de 69, 81, 33 et 44 régiments. De plus, la brigade O'Farell (1er et 84e régiments) forme la garnison de Constantinople, et les 3e, 48e, 51e et 2e régiments légers (77e) participent à l'expédition de la Baltique (août 1854).
Le régiment de ligne était composé de trois bataillons (deux de campagne, un de réserve), et par décret du 24 mars 1855, de quatre (y compris la réserve). Il y avait 8 compagnies dans le bataillon - 6 fusiliers, grenadiers et voltigers (il n'y avait pas de compagnies d'élite dans la réserve, c'est-à-dire le 3e ou le 4e bataillon).
Le régiment d'infanterie légère était divisé en 3 bataillons de 7 compagnies :
carabiniers, voltiger et 5 chasseurs. Pendant la guerre (15 novembre 1854, après l'abolition formelle de l'infanterie légère), la 8e compagnie (jaeger) (3e bataillon) est rétablie. Sur le plan tactique, il n'y avait aucune différence entre l'infanterie de ligne et l'infanterie légère, bien que le canon Voltiger de cette dernière soit 5 cm plus court que le mousquet d'infanterie.
Contrairement aux reconstructions ultérieures de l'infanterie en demi-caftans (pour une raison quelconque, appelées «tuniques» dans l'uniformologie russe!), En Crimée, un fantassin (à de rares exceptions près) n'apparaissait qu'en pardessus et en bonnet - peut-être le plus simple et l'équipement le plus pratique parmi les soldats de toutes les armées européennes de ces années. Un képi à visière carrée portait alors officiellement le nom plutôt encombrant de "chapeau de fourrage à visière" et ressemblait extérieurement à un shako réduit. La couronne et le bas du képi dans l'infanterie étaient en tissu rouge, et la bordure (d'une dentelle de 2 mm d'épaisseur) le long d'eux, comme la bande, était en tissu bleu foncé (règlement du 30 mars 1852). Un numéro de régiment rouge (jaune dans l'infanterie légère) (35 mm de haut) était cousu sur la bande. La mentonnière manquait. La visière était quadrangulaire (largeur au milieu 50 mm), mais avec des coins arrondis : « l'arc du pli extérieur est aplati vers l'extérieur sur environ sept centimètres ». Le matériau de la visière était en cuir verni noir, la coupe était encrée à l'encre. Les tailles pour la casquette sont les suivantes. Hauteur 140 mm à l'avant et 160 mm à l'arrière, diamètre inférieur - au moins 120 mm. Cependant, le fond étant enfoncé de 2 cm vers l'intérieur, la hauteur réelle du bouchon a été réduite à 120 et 140 mm, respectivement. (Mais dans le texte de 1852, lors de la confirmation des premières dimensions, la hauteur à l'arrière est indiquée à 160 mm !) Largeur de bande - 50 mm (dans les années 1850, ces dimensions ont probablement légèrement diminué - le règlement de 1858 fixe une largeur de 45mm) . Contrairement à la charte, une mentonnière pouvait être portée.
Il est intéressant que des mémoires russes mentionnent comment, lors de l'armistice et de la communication entre les soldats des deux camps, « nos chapeaux ronds (bonnets – Auth.) vivement tordus sur les hanches sont apparus sur la tête des Français, en échange des bonnets trouvés par nos très élégants soldats. Engels, soit dit en passant, a écrit à propos du képi: "une coiffure la plus appropriée pour un soldat de toutes celles jamais inventées".
Les instructions au Corps d'armée de l'Est datées du 9 mars 1854 étaient muettes concernant les uniformes des troupes. Par conséquent, les premiers régiments envoyés à la guerre sont partis en shakos. Lors de la revue de Gallipoli le 2 mai 1854, deux (sur trois) régiments d'infanterie de la 1re division, les 7e et 27e de ligne, portent un shako. (Le troisième régiment, le 20e de ligne, est représenté dans le dessin de Vanson dans une casquette, et il y a traversé toute la campagne.) pot" parmi les articles d'uniformes de marche.
Par conséquent, il est nécessaire ici de donner une description du shako, bien qu'il soit douteux qu'il ait été porté du tout sur le territoire de la Crimée. Le shako en forme de cône tronqué inversé était gainé de tissu bleu foncé (« bleu royal »), la dentelle autour du haut et les bordures sur les côtés étaient en laine rouge (jaune dans l'infanterie légère). Dimensions Shako : hauteur 20 cm à l'arrière et 17 cm à l'avant. L'insigne du shako était toujours en cuivre ("quel que soit le métal des boutons"), en forme d'aigle (hauteur 115 mm), regardant vers la gauche ; sous les griffes de l'aigle couper le numéro du régiment. Le pompon est ovale, avec un numéro de compagnie en laiton pour les Fusiliers (pour les rangers des régiments légers, le numéro de compagnie est en métal blanc). Le pompon était fixé sur le bord supérieur du shako, masquant partiellement la cocarde tricolore (diamètre 58 mm).
Couleur pompons :
Compagnies du centre du 1er bataillon : pompon bleu foncé.
Compagnies du centre du 2e bataillon et état-major : pompon rouge.
Compagnies du centre du 3e bataillon : pompon jaune.
Compagnies d'élite des régiments de ligne et légers : double pompon, de « sphère » et « sultan ». Le diamètre des billes est respectivement de 45 mm (inférieur) et 60 mm (supérieur). La couleur des deux pompons est rouge (Grenadiers/Carabinieri) ou jaune (Voltigeurs).
La couverture du shako était en toile cirée noire. Des deux côtés, il avait des revers, montant jusqu'en bas et attachés avec un nœud devant. Le numéro du régiment était appliqué devant avec de la peinture jaune (blanche dans les régiments légers). Cependant, dans le dessin de Vanson mentionné ci-dessus, ces couvertures ne sont pas portées, ce qui, apparemment, parle en faveur de la version selon laquelle les shakos n'ont été retirés des cartables que lors de l'examen.
Ce n'est que le 30 janvier 1855 que l'aigle sur une plaque de shako reçut une couronne, et la jugulaire en cuir noir fut alors remplacée par une paire de lanières de cuivre à 16 écailles (il y avait toujours une étoile à cinq branches sur les rosaces).
Le tambour-major en uniforme de tous les jours portait un bonnet de fourrure noir sans chapeau et un sultan, avec un double pompon d'un petit bâton - la «sphère» est bleue, le «sultan» est blanc et écarlate. En dehors de la formation, ce grade était censé avoir un chapeau. Soit dit en passant, il convient de noter que sa canne dans la campagne a parfois servi d'arme. Comme le rappelait Charles Duban du 11e régiment léger, sur la colline de Malakhov, le tambour-major "allongeait un soldat russe à chaque coup de sa grande canne à pommeau d'argent".
Le pardessus reste traditionnellement le vêtement de marche du fantassin français. Au début de la campagne de Crimée, le modèle de 1844 fut utilisé avec les modifications de 1845 et 1852. Le pardessus était cousu à partir d'un tissu gris-bleu («gris-bleu-fer»), avec un col de la même couleur et deux rangées de six boutons. La distance entre les rangées, conformément aux exigences de la mode militaire légalisée, était de 240 mm (première paire en haut), 205 (3ème paire de boutons) et 140 mm (paire en bas). Avec l'introduction d'une nouvelle ceinture en 1845, un rabat avec un bouton est apparu sur le côté gauche (du point de vue du porteur) du pardessus, conçu pour maintenir la ceinture en place. De l'intérieur, cette valve était ourlée de cuir.
Le volume du pardessus était réglé à l'arrière par une sangle boutonnée. Les planchers du pardessus (avec une petite fente à l'arrière) doivent être enveloppés et attachés. Mais en campagne, ils faisaient souvent exactement le contraire, et au contraire retroussaient leurs manches.
Le col mesurait 60 mm de haut, avec une grande découpe frontale de 70 mm de large. Dans l'infanterie, des valves colorées à trois bras étaient cousues sur le col - rouges dans les régiments de ligne et jaunes dans l'infanterie légère. La largeur du rabat était de 50 mm aux orteils et de 30 mm à l'encoche.
Les poignets sont droits, sur un petit bouton (et un autre bouton se trouve au-dessus du poignet sur la manche).
Les boutons sont en laiton, semi-convexes, avec un numéro matricule bombé estampé, entourés d'une bordure ronde se terminant à chaque extrémité par une fleur.
Le diamètre des gros boutons était de 23 mm et celui des petits boutons de 17 mm. Dans des étagères claires, des boutons en étain, ornés d'une corne (à l'intérieur son numéro de régiment), entourés d'une bordure à vignettes, le long du pourtour d'un rebord.
Sur les épaules du pardessus se trouvent des contre-épaulettes pour les épaulettes (réarrangées du semi-caftan). Ces épaulettes étaient vertes (fusiliers - compagnies centrales), écarlates (grenadiers / carabiniers dans les régiments légers) ou jaunes (voltigeurs). Cependant, officiellement, les fusiliers (chasseurs d'infanterie légère) étaient censés avoir des bretelles en tissu de pardessus, avec des extrémités à trois bras (au niveau de l'emmanchure), et le 100e régiment de ligne utilisait en fait de telles bretelles en 1861. En revanche, les 20e et 27e régiments de ligne, représentés sur le dessin de Vanson (2 mai 1854) en pardessus, portent des épaulettes frangées.
Le texte de 1845 supprime le pardessus de sous-officier "à la taille" - une coupe plus ajustée, sans bretelles dans le dos. L'emplacement des boutons mettait l'accent sur la «taille de guêpe»: la distance entre les 1ère, 3ème et 6ème paires de boutons était de 280, 240 et 100 mm, respectivement. Cependant, malgré l'ordre, un tel pardessus du rang était toujours porté dans la campagne de Crimée - dans le 20e régiment linéaire et au moins dans un régiment léger.
En Crimée, des uniformes d'hiver ont été délivrés à la fin de 1854, dont les fameux "pardessus de Crimée", Crimennes. « D'excellents manteaux de tissu avec des capuchons ont été introduits dans l'armée ; ils sont portés dans des manches avec des boutons en forme ; les officiers ont reçu les mêmes manteaux, appelés ici "Crime", et ont reçu l'ordre de porter des épaulettes dessus », commentaires du côté russe des tranchées.
La confection de ces pardessus débuta dans les vestiaires régimentaires par décision du 23 août. Le capitaine Külle du 20e régiment léger confirme que « chaque officier ou soldat recevait un pardessus à capuche, presque tous un manteau de fourrure court et de grandes jambières [bottes ?] en peau de mouton », ainsi qu'un fez rouge sans brosse ni sabots.
Concernant ce dernier, il convient de citer une note d'un officier russe. Le 28 septembre 1854, il découvre "de nouvelles traces de l'ennemi: ... des sacs à dos russes échevelés, dans lesquels il n'y avait pas une seule botte de rechange, à la place des sabots traînaient, jetés, probablement en raison de l'inapplicabilité de ces chaussures à la boue d'automne de Crimée, pour laquelle les bottes d'un soldat russe valaient bien mieux." Alabin, interrogeant un Français capturé le 2 mars 1855, à la question « Pourquoi ne les portez-vous pas [sabo] ? a reçu la réponse suivante: "Les miens étaient usés, alors mes camarades et moi avons fait don de nos sabots et en avons fait un bon feu."
L'apparition des « pardessus de Crimée » (dans les sources russes appelées « manteaux » ou « capes ») n'était autorisée par aucun règlement, mais était en fait reconnue par le ministre de la Guerre, qui ordonna l'achat de 60 000 exemplaires. Ils se distinguaient de l'échantillon autorisé par la présence d'une cape ou d'une cagoule (« col »), ou les deux à la fois. Devant le plancher de la capote, il y avait deux poches horizontales discrètes avec ou sans rabats. Des manchettes étaient présentes sur ces capotes, mais, apparemment, elles ne pouvaient pas être clairement fixées.
Selon Wanson, les crimennes délivrées en 1854 étaient taillées dans du tissu bleu foncé (couleur uniforme) pour les régiments de ligne et dans du tissu de pardessus pour les régiments légers.
De plus, il y avait (49e régiment de ligne, par exemple) des variantes faites du même matériau à partir duquel le pardessus de l'infanterie anglaise était cousu - gris foncé, avec des boutons en fer plat. En 1855, l'infanterie recevait déjà trois types de crimennes : d'un pardessus en drap à boutons jaunes bombés sans symboles ; tissu bleu foncé avec les mêmes boutons; tissu gris-marron clair, sans cape, mais avec une capuche et une rangée de boutons noirs en bois ou en os. Sont également mentionnés (1855) les pardessus gris, bleu ciel ou verts. Les Crimennes du pardessus en tissu des soldats des compagnies d'élite se distinguaient par des grenades ou des cors de chasse en tissu rouge au bas de la cape ou de la capuche (sur la longueur du bord vertical). La grenade était cousue directement sur le pardessus (dans les 21e et 31e régiments - à un angle de 45), et la corne de voltigeur était cousue verticalement (horizontalement dans le 21e régiment).
Avec les "pardessus de Crimée", ils distribuaient souvent des manteaux en peau de mouton blanche avec de la fourrure à l'intérieur. Il semble que souvent ces manteaux en peau de mouton n'étaient que de la peau de mouton, interceptés par des ceintures. Charles Duban du 11e régiment léger notait que "la peau de mouton se portait grâce à deux sangles, l'une derrière le cou, l'autre jusqu'à la ceinture ventrale". Du camp près de Sébastopol, le 3 décembre, ils ont écrit : « Nous avons déjà reçu des vêtements en peau de mouton, que nous portons avec de la laine à l'intérieur. Il sert à un double usage, car il nous garde au chaud et préserve nos tuniques [semi-caftans], dont le tissu est déjà usé. Quant aux pantalons, un nombre important d'entre eux sont reprisés, et en de nombreux endroits ils sont déchirés faute de lambeaux. Ils recherchent des peaux de vache, qui sont séchées et à partir desquelles le genre de bottes est fabriqué. ... Les chaussures et les semelles usées sont souvent remplacées par des chaussures de raphia, et tout le reste, les jours de l'examen, est si sale que seule l'arme brille.
Introduit grâce à l'expérience de Crimée en janvier 1855.
le nouveau pardessus différait par les détails suivants de l'échantillon précédent :
Deux rangées de cinq boutons ; la distance entre eux est de 100 mm (en bas) à 160 mm (en haut).
Col montant (« saxon »), large de 17 cm, arrondi aux angles. Par temps froid, le col pouvait être relevé, couvrant les oreilles et l'arrière de la tête.
La coupe du pardessus est suffisamment ample pour pouvoir être portée par-dessus un demi-caftan et une veste.
Le contingent en Crimée reçut sans doute un tel pardessus : en novembre 1855, des soldats du 20e régiment de ligne, dont le tambour-major, en furent équipés.
La veste servait de vêtements de travail pour les soldats, qui différaient de l'uniforme précédent par l'absence de queues de pie. En Algérie, la veste servait d'uniforme d'été, et dans la plupart des campagnes, la veste (à la fois en combinaison avec un pardessus et sans elle - et parfois un pardessus, sans veste) était de facto la tenue de marche du soldat reconnue. La veste de l'infanterie était du même tissu à partir duquel les semi-caftans étaient cousus. Il était fermé par neuf petits boutons d'uniforme. Un col montant (en 1855 sa hauteur a été réduite à 45 mm), avec une découpe, dans les compagnies d'élite décorées d'une grenade ou d'une corne en tissu rouge. (Dans les régiments légers, le col est jaune, avec des emblèmes bleus pour les compagnies d'élite.) Parfois, un passepoil rouge peut aller le long du côté. La manchette est droite, au-dessus se trouve un petit bouton en forme. Sur le côté gauche, il y a une valve pour maintenir la ceinture. Les galons selon les grades étaient situés obliquement sur la manche de la veste, comme sur un pardessus.
La situation avec les marques d'épaule de la veste n'est pas tout à fait claire. Le règlement de 1845 approuvait les bretelles à ce titre. En juillet 1848, la République les remplace par des contre-épaulettes, ou contre-épaulettes, entendant ne laisser aux soldats qu'une seule veste, supprimant le demi-caftan. Les contre-chauffeurs, à leur tour, disparaissent le 13 novembre 1848, et la décision de les supprimer est réitérée (à l'exception d'Alger) le 5 septembre 1853. Cependant, l'ordre n'était observé qu'en métropole, et hors de France, les fantassins, selon l'ancienne coutume, attachaient leurs épaulettes sur les épaules de leurs vestes. Pour quoi, un bouton était cousu au col sur chaque épaule.
Pour compléter le tableau, il convient de décrire le demi-caftan de l'infanterie. En tout cas, il (avec épaulettes) est porté par le 7e régiment de ligne lors du dessin mentionné à plusieurs reprises ci-dessus par Wanson de la revue à Gallipoli le 2 mai. De plus, il semble que les sous-officiers pouvaient également porter un demi-caftan lors de la marche, lorsque les soldats étaient en vestes et pardessus.
Le semi-caftan à boutonnage simple (1x9 boutons) était cousu à partir d'un tissu bleu foncé ("bleu royal"). La longueur du plancher est de 43 ou 44 cm, pour les officiers 46 ou 47 cm.Le col (avec une découpe) est jaune en infanterie légère et bleu foncé avec liseré rouge en linéaire.
Le passepoil sur le côté, les poignets pointus (dans l'infanterie légère) et les rabats de manchettes (1x3 petits boutons ; dans l'infanterie de ligne), rabat pour maintenir la ceinture et rabats de poche à l'arrière ("à la Subise", chacun avec 2 boutons) étaient rouges (jaunes dans les étagères claires). Les poignets des étagères linéaires sont rouges, droits. Au col dans les compagnies d'élite se trouve une grenade rouge (dans une compagnie de grenadiers) ou un cor de chasse jaune (voltigeurs);
dans les compagnies de carabiniers et de voltigeurs des régiments légers, ces emblèmes étaient bleus.
Boutons comme sur un pardessus.
Les contre-épaulettes du demi-caftan étaient bleu foncé avec un passepoil rouge/jaune.
Les épaulettes sont en laine, frangées, écarlates (grenadiers/carabiniers), jaunes (voltigeurs) ou vertes avec des demi-cercles écarlates (chasseurs/fusiliers). Doublure épaulette en tissu uniforme. Les caporaux des tambours et des clairons utilisaient des épaulettes de grenadier, bien que leurs subordonnés portaient les épaulettes de leurs compagnies. Musiciens : épaulettes jaune-or sans frange, épaulettes et dont le champ était barré au milieu d'une bande rouge de 25 mm de large. Ce sont ces épaulettes colorées que tous les grades ont été transférés d'un demi-caftan à un pardessus en cas de campagne.
Galons à manches par rang (semi-caftan et veste) - 22 mm de large, cousus en diagonale (orteil, pointe vers le haut, en infanterie légère), en laine rouge / jaune; sous-officiers - rayures dorées avec une bordure rouge (argent avec une bordure jaune dans l'infanterie légère). Le système suivant a été appliqué. Caporal : deux galons sur l'avant-bras. Sergent et Senior Sergeant : 1 ou 2 patchs métalliques d'instruments, respectivement.
Capitainearmus :
deux galons métalliques sur l'avant-bras et un sur l'épaule. Longs chevrons de service (la partie supérieure de la manche gauche du demi-caftan, mais pas le pardessus) en forme de V inversé, de laine écarlate ou, pour les sous-officiers, d'or (argent dans les régiments légers) sans bordure .
Clairons et tambours : galon tricolore au col et aux parements du demi-caftan ;
le cordon de tuyau est également tricolore. Quant aux musiciens, seules des épaulettes les distinguaient en tenue de marche (pardessus).
Depuis juillet 1829, le fantassin français s'est toujours vu attribuer un pantalon long assez spacieux en drap rouge (semi-fin pour les sous-officiers), doublé de creton de coton. « J'ai entendu dire, ajoute Berg, que le drap rouge a été introduit dans l'armée française à cause du bon marché de cette couleur. "Quant aux redingotes et pardessus, un colonel français m'a dit : nous comprenons la dignité de la couleur grise, mais dans notre armée, personne ne la portera puisqu'une personne a mis un manteau gris." Ainsi, les Français de Crimée étaient «pleins de fleurs» dans leur pantalon rouge ... À partir du 31 décembre 1841, le pantalon devait être attaché non pas avec un tour, mais avec une braguette à 4 passants et boutons. Le pantalon avait des cordons de serrage à l'arrière pour ajuster la taille. Sur la droite se trouvait une poche qui s'ouvrait non seulement verticalement, mais aussi horizontalement, le long de la couture de la taille. Un bouton (tous les boutons du pantalon étaient en os noirci) maintenait cette poche à angle droit. Règlement du 30 janvier 1855
a annulé les sangles, "dont la boucle, sous la pression de la ceinture et de la sacoche, alourdissait le soldat".
Chaque soldat disposait d'une paire de guêtres en toile blanche et en cuir noir.
Les leggings d'été en toile (avec des rayures également en toile) étaient attachés avec une rangée de 9 boutons en os. En 1855, un nouveau modèle a été adopté - avec 11 oeillets et 17 boutons en os. La présence de six boutons supplémentaires permettait soit de mieux ajuster les guêtres à la jambe, soit, si on le souhaitait, de mettre le pantalon dans les guêtres en uniforme de marche. (Habituellement, les pantalons étaient encore portés sur des leggings pendant la campagne.) Les leggings en toile étaient disponibles en trois versions : 30, 29 et 28 cm de haut.
Les jambières en peau de vache étaient déjà encrées par les soldats eux-mêmes. Ils étaient attachés à l'intérieur de la jambe avec un cordon de cuir passé à travers 10 trous de cuivre percés le long du bord et 9 trous le long du bord devant la fente. Ces leggings étaient également vendus en trois tailles: 23, 22,5 et 22 cm de haut.Les leggings noirs étaient destinés aux uniformes de travail et aux intempéries, mais cette option particulière était la plus populaire en Crimée.
De plus, près de Sébastopol, des jambières en peau de mouton blanche avec de la laine à l'intérieur (bottes en feutre russes?), Ainsi que des jambières en toile grise ou marron au-dessus des genoux, attachées sur le côté avec une boucle, ont été utilisées.
Une large ceinture de flanelle bleue ou rouge envoûtante était souvent portée sur la ceinture sous la ceinture. Autour du cou, le soldat devait porter une cravate rigide noire. Mais il n'était porté qu'en uniforme de cérémonie, et même les instructions aux troupes en Crimée reconnaissent officiellement le port d'un foulard bleu ciel foncé lors d'une campagne. (Les Unters pouvaient officieusement s'offrir une écharpe en soie noire.) Depuis 1843, les fantassins portaient (sauf pour les exercices et les manœuvres) des gants de coton blanc.
A partir du 4 mars 1845, une cartouchière en cuir noir est portée sur la ceinture à l'arrière, légèrement à droite (pour laquelle une longue lanière de cuir lui est attachée à l'arrière). Volumes du sac (avec couvercle) : 210 mm de long (la boîte réelle occupait 190 mm), 55 mm de large et 100 mm de haut (90 mm sans couvercle). Une poche pour capsules (longueur 175 mm) était dissimulée sous le couvercle. La ceinture elle-même était en peau de taureau noircie (depuis 1848), d'une largeur de 55 mm, en fonction de la taille du soldat. D'un côté de la ceinture, une plaque de cuivre lisse (65x60 mm) et un morceau de ceinture supplémentaire (5 mm - ou 5 cm?) Étaient fixés, et de l'autre - un fermoir en cuivre en forme de lettre D. Sur le dos de la ceinture, le numéro du régiment a été appliqué (disons, "75edeL"), la date de réception (disons "45" pour 1845) et le numéro personnel du soldat (par exemple, "918" ou "192" ). Une paire d'anneaux mobiles en cuivre sur la ceinture (hauteur 78 mm) retenait les bretelles de la sacoche. Une lame pour une baïonnette était attachée à gauche - également en cuir noirci. Le fourreau à baïonnette avait un bracelet en cuir noirci. Pour les grades armés d'un sabre en 1831, une lame spéciale sur une ceinture devait être en cuir noirci, de 26 cm de long, 5 cm de large en haut et 8 cm en bas.
L'insigne pouvait être retiré du harnais sans arracher le morceau de cuir cousu au dos; la cartouchière et la lame à baïonnette étaient donc munies de sangles d'une longueur suffisante pour pouvoir, elles aussi, être retirées si nécessaire. Seule la lame pour porter un sabre était étroitement attachée à la ceinture, qui était donc portée sous toutes les formes. Soit dit en passant, dans le désordre, un soldat portait soit une baïonnette (fusilier / chasseur), soit un sabre (compagnie d'élite ordinaire).
Le sac à dos rectangulaire était recouvert d'un flacon rougeâtre, avec de la laine à l'extérieur, doublé de lin écru. Dimensions : longueur 370 mm, hauteur 310 mm. Deux bretelles en forme de Y de la sacoche étaient attachées à l'arrière de la ceinture du soldat et, à l'avant, elles s'accrochaient à des anneaux mobiles. A partir d'avril 1848, ces ceintures sont remplacées par de nouvelles, composées de trois parties. Le premier, large de 52 mm, se terminait par trois coquilles Saint-Jacques.
Le second passait dans une boucle de fer à simple cheville, située sous le sac à dos.
Le troisième consistait en une sangle fixée au trou dans la partie supérieure de l'anneau mobile en cuivre (sur la ceinture) avec un crochet et un bouton. "Ainsi, la poitrine reste complètement dégagée, et le soldat actuel n'est plus du tout comme ce malheureux soldat qui était serré avec des ceintures et enfermé, selon l'ancien système, dans une sorte de cuirasse de cuir." Au sommet du sac à dos était attachée une couverture d'un semi-caftan ou pardessus, en teck bleu-blanc, le soi-disant. "aux mille rayures", avec des cercles en bois aux extrémités, garnis de pardessus.
Le 28 avril 1854, un nouveau sac à dos fut introduit, dont la description officielle fut publiée le 27 mars 1856 - néanmoins, les troupes en Crimée le reçurent. Dimensions : longueur 36 cm, largeur 11,5 cm, hauteur 31 cm Les cartouches (4 paquets) étaient désormais posées sur une planche dans la partie supérieure du sac à dos, fermées par un couvercle (recouvert d'un flacon) avec une boucle et une sangle.
Les sangles du sac à dos étaient désormais cousues sur le côté supérieur horizontal du sac à dos plutôt que bouclées. Le pardessus était désormais enroulé en rouleau (et plié en fer à cheval sur trois côtés), plutôt que plié de manière cylindrique, ce qui nécessitait deux sangles latérales. Si un soldat recevait une tente de camping, elle s'enroulait simultanément avec une couverture ou un pardessus de camping gris afin que seul le tissu de la tente soit visible de l'extérieur. La caisse en teck est restée, mais les extrémités en bois ont été supprimées;
maintenant, en règle générale, un seul demi-caftan y était caché.
Les ustensiles de camping se composaient d'un chaudron personnel du modèle 1852 (avec un couvercle muni d'une chaîne) et, pour l'ensemble du compartiment, d'un plat (ou d'un grand chaudron), d'un grand flacon et d'une casserole.
La toile de la tente était soutenue par différents types de piquets, en février 1855 un grand support (1,20 m) fut introduit. En Crimée, ce support (accroché sur le côté du sac à dos, du côté de la main gauche) a été capturé par Vanson dans le dessin de deux grenadiers du 31e régiment.
« A la bataille d'Alma, rapporte le maréchal Castellane, les généraux qui ont combattu en Algérie ont ordonné aux soldats, selon la coutume pratiquée contre les Arabes, de déposer les sacs à dos par terre. Après avoir pris les hauteurs, j'ai dû remonter jusqu'à un kilomètre et demi pour les sacs à dos... ». Le 28 mai (9 juin) 1855, P.V. Alabin note : « Presque chaque soldat français a sur lui une fiole de rhum ou de cognac. Ils partent à l'assaut et embrassent leur copine et se sentent chers… ». Capturés et tués lors de l'assaut du 27 août (8 septembre 1855), les Français "trouvèrent des cafetières et des sacs de provisions : saucissons, biscuits, café, rhum et tabac". Le sac du soldat a été autorisé à être porté dans la campagne de Crimée. Il était fait de toile beige ou brune et fermé non pas avec des boutons, mais avec des boucles et des sangles. La fiole n'était également incluse dans aucun règlement, mais était délivrée aux troupes avant chaque campagne. Pendant la guerre de l'Est, des flacons rectangulaires ont été utilisés, d'environ 16 x 14 cm, d'un volume de 1 litre, avec un trou au milieu. Le matériau utilisé était du fer blanc, gainé d'un pardessus - le participant à la défense de Sébastopol se souvenait de «flacons français magnifiquement tressés». À l'aide d'un pochoir ou d'une craie, le numéro du régiment et (moins souvent) le numéro de matricule étaient appliqués sur le tissu. La flasque était portée sur une bandoulière noire.
Armement : fusils à percussion à canon lisse des modèles 1842 (calibre 18 mm ;
longueur 1,475 m, pour voltigeurs 1,421 m), 1853 (longueur comme sur l'échantillon de 1842, mais calibre 17,8 mm) et 1822 T (calibre 18 mm). Version voltigeur du mousquet pour les régiments légers :
une plaque sur la crosse avec les lettres Lr suivies du numéro du régiment (l'inscription a été effacée le 19 juin 1855). Armes de corps à corps : baïonnette modèle 1847 ; les caporaux, les sergents, les sergents supérieurs, les capitaines d'armes, ainsi que les soldats des compagnies d'élite étaient armés en plus d'un sabre de troupes d'infanterie du modèle 1831 (appareil en laiton, lame droite - comme une épée romaine, fourreau en cuir avec casque en cuivre). Tambours, caporal-batteur et musiciens - sabre. Clairons et sapeurs (avec leurs caporaux) - un sabre et un tromblon de gendarme (calibre 17,6 mm, avec un appareil en laiton) avec une baïonnette.
Un participant à la défense de Sébastopol a noté avec une certaine envie: «La pimpreté des vêtements ... Les officiers français ont frappé tout le monde; elles étaient toutes parfumées, en bottes lustrées, en gants de chevreau, en beaux uniformes, à cause desquels on voyait le lin le plus fin et blanc comme neige. Un autre officier russe décrit un collègue français : « Il y avait un mélange de paillettes et de saleté dans ses vêtements : un uniforme neuf et brillant, d'excellentes chaussures - et un pantalon plutôt usé. Une excellente casquette, avec une tresse brillante - et une cravate nouée avec un garrot, ne ressemble à rien d'autre. Même les Britanniques ont admis que les « officiers français sont toujours habillés proprement et bien rangés. Nos officiers… au contraire, ils sont tous en lambeaux et sales.
Un officier du 11e régiment léger décrit la mode des officiers de Crimée à la manière africaine : « Nous portions un gilet noir et un semi-caftan déboutonné, comme en Algérie, des pantalons en caleçons ou caleçons, et par-dessus tout une ceinture zuavienne. Ces semi-caftans non statutaires ressemblaient aux uniformes des officiers zouaves - entièrement en tissu bleu foncé (le noir deviendra à la mode plus tard), avec des boutons d'uniforme et des insignes en forme d'argent ou d'or (infanterie légère et de ligne, respectivement) manche nœuds. Les nœuds étaient constitués de bandes de galon d'or de 3 mm de large et d'une quantité de un à cinq, selon le rang. Les 2e et 4e bandes du lieutenant-colonel étaient en argent, les majors en avaient une inférieure en argent, pour les distinguer des chefs de bataillon. Le capitaine est un ajudan senior : la deuxième bande est argentée. Dans l'infanterie légère, évidemment, le système inverse, avec le remplacement de l'or par l'argent et vice versa. Ajudans portait un seul nœud de soie noire.
Un tel demi-caftan n'est mentionné dans aucun règlement, mais il a été utilisé en campagne par la plupart des officiers de l'infanterie française depuis la conquête de l'Algérie. Parfois, il était accompagné d'un col, de poignets et de bordures latérales rouges (jaunes dans l'infanterie légère) - par exemple, dans le 20e régiment de ligne. Mais, en règle générale, ces éléments de l'uniforme étaient en tissu de la couleur de fond. Dans les compagnies d'élite, leurs différences habituelles étaient portées sur le col - des grenades et, apparemment, des cornes. Comme le vétéran s'en est plaint, de tels semi-caftans se sont rapidement usés en Crimée: «Peu importe à quel prix, il était impossible d'en obtenir de nouveaux.
Habituellement, de nouveaux étaient obtenus en achetant des demi-caftans d'officiers tués. Sous un semi-caftan de Crimée, ils portaient un gilet bleu foncé fermé par de nombreux boutons d'or, une chemise blanche et une cravate noire dont les deux pans retombaient sur la poitrine.
Les jambes des pantalons étaient enfoncées dans des chaussures de randonnée, qui servaient de grandes jambières en cuir noir à boucles ou de hautes bottes noires: pendant les travaux de siège près de Sébastopol, les bottes de montagne sont devenues particulièrement populaires.
Le képi des officiers, contrairement aux soldats, n'avait pas de numéro sur la bande, mais en revanche, il était doté d'une fausse mentonnière en or ou en argent (5 mm de large) et de galons en métal sur la couronne et la bande. Les officiers supérieurs portaient trois galons (métal d'instrument) sur les côtés du haut de la casquette, les capitaines - deux, les grades subalternes - un galon. Pour la "tresse horizontale" (galoons sur la bande) le système suivant a été mis. Sultan : une rangée. Lieutenant : deux rangées. Capitaine : trois. Chef de bataillon et major : quatre.
Lieutenant-colonel et colonel : cinq rangs. Les galons reposaient tous sur du métal d'instrument, à l'exception suivante (en métal opposé à la couleur des boutons) : les 1er et 4e rangs pour le lieutenant-colonel, le 1er en partant du bas pour le major, le central pour le capitaine - l'ajudan senior et la 3ème rangée pour le capitaine instructeur (foot rangers).
La ceinture était attachée à la bande de la casquette avec deux boutons uniformes ou non statutaires. La visière était en cuir verni noir, souvent doublé de maroquin vert. Conformément aux exigences de la mode, la hauteur totale du képi diminuait chaque année, tandis que la largeur de la bande augmentait en conséquence. En 1852, la hauteur du bonnet était de 100 mm à l'avant et de 150 mm à l'arrière, la largeur de la bande était de 30 mm et la visière était de 40 mm au milieu. Il y avait un nœud hongrois au bas de la casquette.
Sur le shako de l'officier il y a des galons d'or/argent (selon le grade) et des cordons, une plaque dorée. Le numéro sur le couvercle du shako est en argent.
Petit bâton pompon :
rouge avec une bordure blanche "sultan" et une "sphère" bleue.
Le semi-caftan uniforme (longueur au sol 46 cm) se distinguait par des liserés rouges sur les rabats du col, des côtés et des poignets. Poignets rouges, boutons dorés, emblèmes dorés des compagnies d'élite sur le col. L'infanterie légère utilisait des boutons argentés, des contre-épaulettes et des épaulettes métalliques, symboles en argent des compagnies d'élite. Depuis 1852, les officiers supérieurs et les officiers du quartier général régimentaire des régiments d'infanterie reçoivent des grenades brodées. Un insigne d'officier (or avec des symboles argentés) et des épaulettes étaient portés avec un demi-caftan, avec une fine frange, de 80 mm de long (officiers subalternes) ou une dentelle épaisse et torsadée, de 60 mm de long (officiers supérieurs). Sous-lieutenant : doré ;
une épaulette avec une frange sur l'épaule droite, sans frange (contre-épaulette) sur la gauche. Lieutenant:
or; emplacement inverse. Capitaine : or ; deux épaulettes frangées. Capitaine - senior ajudan : comme un capitaine, mais argent. Major/chef de bataillon : or ; épaulette frangée à droite, contre-épaulette à gauche. Lieutenant-colonel : argent ; deux épaulettes frangées. Colonel : comme un lieutenant-colonel, mais les épaulettes sont en or. Dans l'infanterie légère, le capitaine - ajudan senior se distinguait par une épaulette en or et des contre-chauffeurs. Le lieutenant-colonel, quant à lui, se distinguait par des épaulettes et contre-épaulettes dorées à demi-cercles et franges argentées.
Un spacieux imperméable bleu foncé («sanglier») sans capuche dans toute l'armée était doublé de tissu rouge (les informations sur la couleur blanche semblent inexactes), sauf pour les rangers à pied (doublure bleu ciel). Pour les officiers, il remplace le pardessus et la redingote. Cette cape avait un col montant, deux fentes dans le dos (40-45 cm de long, avec un bouton noir en haut de chacune) et deux poches passepoilées verticales sur les côtés. Le col, le côté, le plancher du bas, les fentes et les poches étaient gainés d'un galon de soie noire, se terminant par des trèfles (dans la partie supérieure de la fente et aux deux extrémités des poches).
L'imperméable était attaché de chaque côté par quatre lacets de soie noire, attachés chacun au centre d'une béquille gainée de tissu noir. De plus, une béquille plus petite était cousue sur le côté droit, sur laquelle un cordon (comme un mentishket) était attaché, cousu sur le côté gauche. Les poignets (orteils) étaient également gainés d'une tresse noire. Au-dessus d'eux se trouvaient les nœuds hongrois. Pendant la campagne, les « pardessus de Crimée » se sont généralisés.
La ceinture décontractée de l'uniforme d'officier était en cuir noir, de 45 mm de large, avec deux ceintures et un insigne doré (55x55 mm). En Crimée, une ceinture colorée était généralement portée sous la ceinture. Le sabre du modèle 1845 avait une lanière noire, de forme courante avec un pompon noir (en Crimée, cependant, la version cérémonielle était également utilisée, où le pompon était en or). Ajudans s'appuyait sur toutes les formes de sabre d'officier sur une ceinture de tous les jours et avec une lanière ordinaire. En Crimée, les officiers lors d'attaques nocturnes enlevaient leurs fourreaux pour ne pas se trahir par leur sonnerie, et marchaient avec une lame tirée. Dans la forme courante, les décorations d'un tapis de selle, d'une valise et d'un tapis de selle (bordure, galons et numéro) en poil de chèvre étaient rouges (jaunes dans les étagères claires).
Le 24 octobre 1854, l'infanterie légère est supprimée et 25 régiments légers sont convertis en régiments de ligne, avec une nouvelle numérotation, nos 76-100. Le texte précisait cependant que cette décision ne serait appliquée qu'au 1er janvier de l'année prochaine. Les uniformes et les armes des 25 régiments sont temporairement restés inchangés (confirmé le 30 novembre). La réorganisation en Crimée a duré longtemps - l'ancien uniforme a été conservé jusqu'à ce qu'il soit usé. Le capitaine Külle du 95e régiment de ligne (anciennement 20e léger) reporte ce changement à la fin de l'hiver 1854-1855, mais il ne fait aucun doute que seul le numéro sur le képi a alors changé. Alors, bien sûr, il faut comprendre les propos de Wanson, qui remarqua le 18 novembre 1855 que le 79th Line (anciennement 4th Light) Regiment portait "leurs nouvelles casquettes". Ce n'est qu'en février-mars 1856 que le 11th Light Regiment devient extérieurement le 86th Line Regiment, « une transformation très sensible pour les régiments légers, qui avaient une forme plus coquette, des armes plus légères et plus commodes, et enfin, un système de caste plus développé. ” A cette époque, le sous-lieutenant de Latour du Pin débute sa carrière militaire dans les rangs du 81e (ex 6e régiment léger) : « L'uniforme était encore porté et les habitudes de l'infanterie légère étaient conservées : col jaune et bouton d'argent, le commandement : « Carabiniers, en avant ! »».
(Les carabiniers ont également conservé leurs moustaches traditionnelles.) Ce n'est qu'après leur retour en France, en 1856, que les régiments ont revêtu leur uniforme statutaire.
prescrit pour les anciens régiments légers :
Képi : numéro de tissu rouge sur une bande.
Shako (texte daté du 7 juin): galons et cordons rouges pour tous les régiments - cependant, on ne sait pas si cet ordre a été exécuté avant le 17 mai 1856, lorsque les shakos d'infanterie ont reçu une garniture de tresse de laine jaune.
Le nouveau demi-caftan de toute l'infanterie de l'armée : col jaune (bord bleu), haut de 50 mm, boutonné sur toute la hauteur par trois crochets. Le liseré sur le côté est rouge, les poignets sont également rouges avec des valves bleu foncé (le liseré est rouge).
La longueur du plancher uniforme est de 55 cm.Les décorations de col dans les compagnies d'élite ont été laissées du modèle précédent.
Pardessus : rabats rouges sur le col.
Et, enfin, un détail amusant - selon les rapports des correspondants de Crimée, presque tous les soldats français, de nombreux officiers et certains généraux portaient des amulettes, chrétiennes, turques et même juives, croyant fermement en leur pouvoir.
Chasseurs à pied Sur les vingt bataillons de chasseurs alors disponibles dans l'armée (10 compagnies chacun), 12 ou, selon d'autres sources, 13 ont participé aux hostilités en Crimée et en Baltique (n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17 et 19). Contrairement à l'infanterie, les rangers disposaient d'un demi-caftan (règlement du 8 octobre 1845) en guise d'uniforme de marche, complété par temps froid d'un « col à capuche » (cape à capuche).
Le shako (hauteur 190 mm à l'arrière et 160 mm à l'avant, haut 140-160 mm) était gainé de tissu bleu foncé avec passepoil jaune sur les côtés. Le bas, le ruban autour du bord inférieur (hauteur 45 mm) et la jugulaire étaient en cuir verni noir, et le galon autour du haut (largeur 20 mm) et la boutonnière de la cocarde (longueur 95 mm) avec un grand bouton uniforme étaient jaunes. Une cocarde en cuir (70 mm) était fixée à l'avant et sur la bande inférieure en cuir se trouvait un numéro de bataillon en métal blanc (hauteur 30 mm). Le pompon en laine (50 mm) était vert foncé dans toutes les compagnies et le peloton non combattant ; les clairons portaient un pompon tricolore. Visière - comme sur un shako d'infanterie, à un angle de 25 °. De l'intérieur, la visière était peinte en vert et de l'extérieur, elle était gainée d'un bord convexe. En uniforme, un sultan noir et vert de plumes de coq flottantes était porté sur un shako. Sur la couverture du shako, le numéro a été appliqué avec de la peinture blanche.
La casquette Jaeger était bleu foncé, avec un passepoil jaune et un numéro sur la bande (aux rangs inférieurs; hauteur 35 mm). La hauteur de la bande était de 45 mm. La visière reposait sur du cuir verni noir, rectangulaire, de 50 mm de large au milieu. La hauteur totale du capuchon était de 120 mm à l'avant et de 160 mm à l'arrière. Le képi servait de couvre-chef au chasseur, mais au début de la guerre de l'Est, certains bataillons portaient encore un shako.
Par exemple, lors d'une revue à Gallipoli le 2 mai 1854, le 9e bataillon est représenté par Vanson en shako (avec un sultan), alors que le 1er bataillon est présenté en casquette.
Jusqu'en 1860, la couleur du drap en demi-caftan était officiellement appelée "bleu royal" (bleu foncé). Le demi-caftan était fermé par une rangée de neuf gros boutons d'uniforme. Le bord supérieur de la jupe uniforme était légèrement froissé, mais sans véritables plis. Le col (hauteur 60 mm) était bleu foncé avec un passepoil jaune. Le même liseré longeait les poignets pointus (hauteur 110 mm), la planche et les contre-chauffeurs (longueur 90 mm). Les boutons uniformes étaient en étain, 10 mm;
l'emblème était une corne, au centre de laquelle était le numéro du bataillon. Les épaulettes sont vert foncé avec des demi-cercles jaunes. Dimensions de l'épaulette : longueur de frange 80 mm, bandoulière - 65 mm de large (au col) et 110 mm de long, champ d'épaulette - 45 mm de haut et 90 mm de large.
La veste (1x9 petits boutons) n'avait ni passepoil ni bretelles. Sur les poignets (orteil) il y avait deux petits boutons (un, en fait, sur la manche), ainsi que sur le demi-caftan.
Les pantalons ont été coupés dans un tissu de fer gris foncé (95% de laine bleu foncé et 5% de blanc) avec un passepoil jaune. Chaque jambe avait trois plis à l'avant et une poche sur la hanche. Le «col à capuche» (introduit le 10 janvier 1854, coupe similaire au modèle Zouave) était cousu en tissu de fer gris bleuté, sans passepoil. La cape était ornée sur le devant de quatre doubles rabats.
Le règlement a établi les insignes suivants. Sous-officiers, caporaux et soldats de 1re classe : galons en forme de chevrons (pointe vers le haut) en argent à bordure jaune ou en laine jaune. Kaptenarmus : galon (sans bordure) obliquement en haut de chaque manche. Les chevrons d'ancienneté (uniquement sur un semi-caftan) sont en laine écarlate (argent pour les sous-officiers). Sapeurs : sur chaque manche de l'uniforme et de la veste se trouve un emblème en laine jaune sous la forme d'une pelle et d'une hache croisées. Clairon et caporal clairon : galon tricolore au col et aux parements du demi-caftan. Cor-musicien : galon argenté sur le col du demi-caftan. Chef de la fanfare du bataillon : galon d'argent et galons de sergent (22 novembre 1853). Ajudan : épaulettes dorées avec une bande écarlate au milieu, la tresse supérieure du shako est argentée avec une fente écarlate, un pompon tricolore.
Le sac à cartouches (hauteur totale 140 mm, longueur du couvercle 205 mm) était d'un type spécial pour les rangers - sa boîte et son couvercle avaient la forme d'un sac à gibier, arrondi en bas et effilé en haut. La somme (qui n'avait aucun symbolisme) était attachée à la ceinture à l'arrière à droite, mais avançait lors du tir. Sur la ceinture (longueur 1,10 m, largeur 60 mm) en cuir noir, une lame (longueur 195 mm) pour un couperet à baïonnette et deux interceptions en cuivre pour les sangles de la sacoche étaient attachées. La ceinture était fermée par un crochet en cuivre d'un côté et un fermoir en forme de D de l'autre. La sacoche Jaeger ne différait de la version d'infanterie que par la couleur du mollet - noir (se fanant vraisemblablement en une teinte grise avec le temps). Couverture de veste en érable noir en forme de valise; à chaque extrémité il y a un bout en bois, gainé de la même toile cirée. Pour les sapeurs, la sacoche était équipée de deux sangles supplémentaires, en haut et en bas de la sacoche. Ils servaient à sécuriser le matériel qu'ils transportaient - une hache, une pelle ou une pioche.
Armement : soldats, caporaux et clairons - une carabine des modèles 1846 et 1853. et un sabre-couperet du modèle 1842. Une carabine avec une ceinture en cuir ciré noir (longueur 90 cm - dans l'infanterie 93 cm) avec une demi-boucle en cuivre. Ajudans : sabre des officiers d'infanterie.
Sur le shako de l'officier, la bande était en velours noir et le galon supérieur, la boutonnière de la cocarde et les lacets étaient en argent. Le numéro du bataillon sur la bande est ondulé, en métal argenté. Pompon vert en laine, sultan comme soldats (au quartier général le pompon était tricolore). Sur la couverture, le numéro du bataillon était peint avec de la peinture argentée. Selon la tradition (officiellement approuvée seulement à la fin du siècle), les officiers ont une bande de velours noir (sans numéro) sur leur casquette. De plus, la bande sur le capuchon est en argent.
Le demi-caftan de l'officier était cousu dans un tissu fin et sa jupe était décorée d'un nombre différent de "plis ondulés". Dès mars 1852, des officiers supérieurs cousent des grenades en argent sur le col. Les épaulettes reposaient sur l'appareil, l'argent, et la cuirasse était de type infanterie. De même, dans le style de l'infanterie, les officiers des rangers utilisaient hors de la métropole (et en Crimée) un semi-caftan de tous les jours à nœuds hongrois et un gilet à petits boutons d'uniforme. Les pantalons sont également en tissu fin, avec des plis à la taille et des lanières amovibles. Comme déjà mentionné, les rangers à pied étaient les seuls de l'armée à porter une doublure bleu ciel sur leur imperméable. Le sabre des officiers d'infanterie supérieurs (lame droite) ou subalternes (la lame est quelque peu courbée) du modèle 1845 (fourreau en cuir) ou 1855 (fourreau en acier) servait d'arme. Le plus souvent, cependant, une version non statutaire était utilisée - la lame était droite et le cadre à trois bras était en acier.
Harnais de tous les jours en cuir verni noir avec plaque ovale en cuivre doré avec fermoir en forme de S.
Zouaves Trois régiments de zouaves (3 bataillons chacun), que les soldats russes appelaient "Turcs", portaient un uniforme (source inépuisable d'inspiration pour les caricaturistes de l'armée), globalement similaire à celui que j'ai décrit plus haut pour 1870. Les différences étaient les suivantes.
L'iconographie et les négatifs de la campagne de Crimée montrent que certains grades utilisaient encore des vestes à angles droits (la jonction des côtés et les bords inférieurs de la veste), l'ancien modèle. Sur ces vestes, les manches (étroites, selon la mode, comme on peut le voir sur des photographies de Crimée) étaient fermées par des boutons et les côtés étaient gainés d'une simple bordure, sans galon. Sur les deux versions de la veste, le dessin du galon et des fausses poches sur la poitrine était le même. Dès 1855, le 2e régiment (tablette de I. Bellange) utilisait cette veste à l'ancienne. Il faut souligner que les Zouaves ne portaient ni cravate ni foulard autour du cou.
Le turban du fez n'était que vert, de la taille d'une ceinture. « On sait qu'environ 4 régiments de Zouaves portent des turbans verts autour du bonnet rouge [fezze] ; - Erreur signalée par l'auteur.
"Saint-Pétersbourg Vedomosti" pour 1854, n ° 150, - ces derniers suscitent l'indignation générale parmi les Turcs, car leur turban vert appartient à des sectes bien connues et à des descendants de Mahomet.
Les pantalons pouvaient être, comme dans les années 1830-1840, sans galon. Les jambières pendant la campagne de Crimée étaient encore attachées sur le côté avec des boutons en os ou en cuir. Selon Berg, chez les Zouaves « les souliers sont constitués de sandales spéciales, et parfois de souliers ». Le sac à dos, selon le texte de 1853, était « similaire au modèle des rangers à pied, mais à partir d'un veau rougeâtre. Les bretelles ne sont pas fourchues. La sacoche d'infanterie ne se généralise qu'à partir de 1854-1856. "Nos soldats en zouaves n'aimaient qu'une chose : les grandes paupières sur les manières !", se souvient P.V.
Alabin. Armes : fusil rayé à baguette, baïonnette modèle 1822/1847. avec une petite épingle sur le cou (fourreau d'infanterie, mais en cuir rougeâtre). Unters et clairons - carabine d'artillerie modèle 1829 T et sa baïonnette-sabre modèle 1842, et caporaux et tambours - sabre modèle 1831. Sur la ceinture de taille se trouve une cartouchière pour les rangers à pied à l'arrière, une lame à baïonnette de type infanterie ou une lame de sabre pour les caporaux et les tambours. Sous-officiers et clairons: la lame du sabre-baïonnette est cousue étroitement à la ceinture. La carabine Jaeger n'a été émise qu'en 1857, mais des tireurs libres formés près de Sébastopol à partir de rangers à pied et de zouaves (octobre 1854-mars 1855) en étaient déjà équipés.
Le 24 avril 1856, Vanson remarque la présence au 3e régiment de « pardessus gris de Crimée, aux jupes retroussées très haut, avec des boutons plats jaunes avec un numéro ». Quant à la cartouchière (jaeger, selon la charte), déjà sur la tablette de Lales de 1855
sac d'infanterie, et Vanson en avril 1856 a noté que les modèles d'infanterie prédominent parmi les Zouaves en Crimée. Dans le tableau "McMahon et les Zouaves sur la colline de Malakhov, 1855". A. de Neuville 1er Régiment est représenté (8 septembre 1855) en fez sans turbans, à guêtres blanches, d'autres à rouleaux de pardessus, des officiers en demi-caftans (parfois déboutonnés) sur des gilets. A en juger par les photographies de Fenton (n° 20a), en Crimée, les officiers zouaves portaient leur costume réglementaire (un demi-caftan à nœuds hongrois, un gilet, un pantalon à rayures et une casquette), et le client zuavien portait un costume sombre Spencer bleu avec une tresse rouge aux poignets, une jupe bleu foncé avec une bande rouge, un pantalon droit rouge et un fez sans turban.
Les flèches algériennes Turkos pendant la guerre de Crimée se composaient de trois bataillons : Algérie (couleur appliquée rouge), Oran (blanc) et Constantine (jaune). Parmi ceux-ci, un régiment temporaire a été formé (73 officiers et 2025 grades inférieurs), envoyé en Crimée.
Les changements ultérieurs dans l'organisation du corps en janvier (les bataillons ont été divisés en deux) et octobre (toutes les parties ont été réduites à trois régiments de trois bataillons) n'ont pas affecté l'apparence des tireurs, qui était toujours réglementée par le texte de février. 14, 1853. Les nouveaux régiments (nos 1 à 3) ont conservé les couleurs appliquées des anciens bataillons.
L'uniforme des bataillons de fusiliers indigènes d'Algérie ne différait pratiquement pas de celui décrit plus tôt en 1870. Les différences étaient les suivantes. Les dimensions du turban fez blanc jusqu'en 1868 étaient de 4,80 m sur 40 cm, comme sur une ceinture. Le « col à capuchon » de 1853 était en drap bleu ciel, doublé de toile, et fermé par quatre doubles rabats sans boutons. A partir du 26 mars 1855, cependant, les artilleurs ont droit à la version en drap de fer gris bleuté, qui sera portée en 1870. Lors de l'assaut final sur Sébastopol, le lieutenant Lazarev mentionne des "Arabes", des tireurs indigènes qui ne peuvent être que des Turkos. Selon lui, ils étaient vêtus « de leurs beaux manteaux blancs » – manifestement, des burnous à bizutage.
Les jambières pendant la guerre de l'Est étaient encore de l'ancien type, avec des boutons noirs.
Equipement : une cartouchière d'infanterie du modèle 1845, une lame à baïonnette d'un échantillon général, un sabre de 1831 était porté par les caporaux et les sous-officiers ; fourreau à baïonnette comme dans l'infanterie, mais en cuir souple. Armement : comme dans l'infanterie de ligne. Officiers français en 1855
il était censé donner un uniforme de type oriental, mais cette intention est restée au stade des plans.
Légion étrangère En mai 1854, l'Empereur envoya la majeure partie de la Légion étrangère (qui se composait alors de deux régiments d'infanterie) à l'armée de l'Est. Les deux régiments ont alloué deux bataillons. Puis, près de Varna, à partir des compagnies de grenadiers et de voltigers de ces quatre bataillons, un bataillon de marche ou « bataillon sélectif » du major Nairal (à la 1re division) est créé, envoyé en Crimée, où il se distingue à Alma. En octobre, les compagnies restantes du Leather Belly débarquèrent sur la péninsule et le bataillon fut dissous.
La légion a formé l'une des brigades («brigade du chou») de la 5e division, a participé au siège de Sébastopol. Après la signature de l'armistice, la Légion (à partir de janvier 1855 la "Première Légion Etrangère", et à partir du 16 avril 1856 le 1er Régiment Etranger, mais la réorganisation n'est effectuée qu'en juin) revient à Alger.
La Légion utilisait les uniformes, l'équipement et les armes de l'infanterie de ligne, avec les différences suivantes. L'utilisation du shako était limitée à des défilés exceptionnels, et il y a des doutes qu'il ait été émis du tout - et plus encore a été utilisé en Crimée. (Le règlement du 20 mars 1852 ordonna que le shako soit laissé au dépôt des troupes envoyées en Afrique du Nord.) Concernant le semi-caftan, il existe une opinion selon laquelle il n'a pas été reçu par les hommes de troupe inférieurs au grade de sergent , qui se contentait d'une veste et d'un pardessus.
Sur les boutons au centre se trouvait le numéro du régiment, entouré du nom :
"Premier/Deuxième Régiment Etrangré". Le 17 janvier 1855, une nouvelle légende apparaît sur les boutons : "Premire Lgion Etrangre". En été, à la campagne ou dans les appartements, les légionnaires utilisaient souvent des pantalons en toile non peinte, taillés selon le modèle de tissu.
(Dans l'infanterie régulière, ce pantalon blanc a été aboli dès 1832-1834.) Selon certains rapports, l'imperméable d'officier de la Légion avait une capuche. L'environnement du camping a contribué à la propagation des barbes et des moustaches. (Selon la charte, seuls les sapeurs étaient autorisés à avoir des barbes, des moustaches et des «mouches» - une barbe sous la lèvre - aux compagnies de flanc, et seulement des moustaches aux compagnies centrales.) Le 18 janvier 1856, des fourreaux en acier ont été introduits pour sabres d'officiers produits l'année précédente. Cependant, dans la Légion, à en juger par l'iconographie, non seulement les sabres d'infanterie autorisés ont toujours été populaires, mais aussi les échantillons introduits pour les Zouaves et les rangers à pied. Sac à dos modèle 1854/1856 n'est apparu dans la Légion que trois ans plus tard.
Une poche abdominale en cuir noir était également portée (devant une ceinture) en Crimée, c'est pourquoi les légionnaires ont reçu leur premier surnom - «Leather Belly». Les sabres du modèle 1831 de la Légion, semble-t-il, n'étaient plus utilisés, mais le sac de cartouches d'infanterie, apparemment, était utilisé à égalité avec la poche. Armes : Mousquets 1822 T et T bis.
Des sources nous ont apporté plusieurs anecdotes liées au costume des légionnaires en Crimée. La plus célèbre est l'histoire d'un vétéran qui a bu ses bottes et s'est présenté pieds nus à une revue d'inspection, peignant ses pieds en noir, dans l'espoir qu'ainsi son méfait ne serait pas remarqué. Sous cette forme, il se tenait dans la neige !
Pendant l'armistice près de Sébastopol, lorsque les deux parties se sont rassemblées et ont enterré les morts, les légionnaires se sont précipités pour enlever leurs pardessus, manteaux de fourrure courts et bottes des soldats russes, sans parler d'autres petites choses et, bien sûr, de l'argent (le cas échéant) . L'image d'un légionnaire à l'hiver 1854 comprend une couverture drapée sur ses épaules, des leggings sales et reprisés, des sabots et un uniforme rapiécé. Dans un autre dessin, une écharpe à carreaux est visible, nouée sur les oreilles, sous le bonnet. Ici, des leggings en toile et une ceinture de laine rouge ou bleue sur un pardessus, uniforme ou "Crimée", attirent l'attention.
Partout il y a une énorme pochette en cuir, qui a donné le surnom à la Légion.
Lorsque la mascotte régimentaire du 23e régiment (Royal Welsh Fusiliers), une chèvre, a été empoisonnée par des légionnaires, elle a été enterrée par les Britanniques avec tous les honneurs dans le cimetière d'Inkerman. Pendant la nuit, les mêmes légionnaires ont déterré le cercueil, écorché le mort et l'ont enterré. La peau a été tirée au sort et le gagnant, après avoir fait preuve d'ingéniosité, en a cousu un manteau en peau de mouton confortable et chaud. Mais, ne l'ayant porté qu'un jour, le légionnaire rencontra un major du même 23e régiment, qui, admiratif de ses vêtements, offrit au Français 20 livres pour elle, ce qu'il accepta volontiers.
Le major a mis un court manteau de fourrure et est allé au régiment, et le légionnaire a couru chercher à boire.
L'histoire ne dit pas si le matériau de ce manteau en peau de mouton a été identifié et quelle a été la réaction des guerriers britanniques face à une telle ruse de la part de leurs alliés ... Corps (Prince Napoléon) de l'armée de l'Est. Le régiment a opéré sous Alma, a participé au siège de Sébastopol. Au cours de la campagne, il a été converti en 4e Régiment de Marines (1854).
Selon le règlement du 1er juillet 1845, le shako des marines se distinguait par le fait que son insigne était un aigle sans couronne, tenant un écu avec le numéro du régiment dans ses griffes. L'écu était entouré de feuillages de chênes et de lauriers, à droite et à gauche il était soutenu par deux ancres placées en biais. Le pompon est jaune, avec un sultan jaune (tricolore au siège).
Le képi (officiellement appelé le "cercueil"), les marines étaient censés être bleu foncé avec un passepoil écarlate autour du bas, sur chacun des quatre côtés de la couronne et le long du haut et du bas de la bande. Également sur la bande était une ancre écarlate. La distinction des marines était une mentonnière avec un cordon (sur deux petits boutons d'uniformes) et une visière ronde (jusqu'en 1856). En été, il était permis de porter un chapeau de paille tressée, souvent garni d'une bordure noire le long de la couronne et orné d'un emblème en forme d'ancre.
Le demi-caftan bleu foncé (2x7 boutons) était garni d'un liseré écarlate, il y avait une ancre écarlate sur le col, et les parements (orteils) étaient de la couleur de fond. Le col et la partie supérieure du côté pouvaient être repliés, ce qui permettait de voir les ancres sur les revers de la poitrine.
L'ancre et le numéro de régiment étaient sur les boutons. Les épaulettes étaient jaunes dans toutes les compagnies.
Les pantalons reposaient sur une teinte bleu-gris-fer avec une bande écarlate. Les pantalons d'été étaient cousus à partir de toile blanche. La chemise était blanche avec une cravate noire.
Équipement - cuir blanc, insigne de ceinture - cuivre rectangulaire, avec une ancre. À la ceinture, les fantassins portaient une poche, une baïonnette et un sabre du modèle 1831 - tous deux dans un fourreau en cuir noir avec une bordure en laiton. Arme : échantillon de pistolet à percussion 1853 T (calibre 17,8 mm). En 1855, une carabine Jaeger avec une balle Minier a été émise, et une baïonnette-sabre combinée a remplacé la baïonnette et le sabre.
Les officiers ont cousu leur demi-caftan à partir d'un fin tissu noir. Leurs ancres de col étaient brodées d'or, sur fond de velours noir. Les boutons sont dorés, les épaulettes sont dorées. L'insigne de l'officier était également doré, avec des symboles argentés - un aigle, assis sur une ancre enlacée avec une corde. En 1856, les marines ont été autorisés à porter un semi-caftan sans épaulettes en uniforme de tous les jours, où les grades étaient déterminés par des nœuds de manche en or hongrois. Peut-être, alors, la pratique déjà utilisée dans la guerre n'a-t-elle été que légalisée. Avec une chemise blanche et un nœud papillon noir, les officiers portaient un gilet bleu-noir fermé par une série de boutons dorés.
Sur le shako de l'officier, les galons étaient d'or, l'insigne était doré ; sur le képi il y a des galons d'or faits d'une tresse plate, sur le fond il y a un nœud hongrois et sur la bande il y a une ancre d'or enlacée avec une corde. La ceinture de cérémonie était en soie, avec des broderies dorées et trois bandes écarlates, un insigne ovale avec un aigle. Sabre modèle 1845, dans un fourreau de cuir noir. Sur le cadre du sabre (en laiton doré), il y avait aussi une place pour un thème marin - une ancre sous la couronne. En campagne, les officiers étaient souvent armés d'un pistolet de marine à percussion du modèle 1837 ou 1842-1849. ou un pistolet d'officier de cavalerie 1833.
Artillerie et génie Par décret de l'Empereur du 14 février 1854, l'artillerie de France avait l'organisation suivante :
Cinq (nos 1 à 5) régiments d'artillerie à pied, composés de 12 compagnies d'artilleurs-serviteurs, ou batteries à pied, et de 6 compagnies d'artilleurs-conducteurs, ou batteries de parc.
6e Régiment d'Artillerie-Pontonniers (12 compagnies de canonniers de ponton et 4 compagnies de canonniers à cheval).
Sept (nos 7-13) régiments d'artillerie itinérante, composés chacun de 15 batteries itinérantes. Les serviteurs de ces batteries étaient transportés sur des caisses de chargement et des avant-trains de canons.
Quatre (nos 14-17) régiments d'artillerie à cheval avec 8 batteries à cheval chacun. Cavaliers et serviteurs voyageaient à cheval.
12 compagnies d'ouvriers d'artillerie.
Cinq compagnies d'armuriers.
De plus, chaque régiment avait un quartier général, un peloton non combattant et un cadre de dépôt itinérant.
Les batteries de campagne (de conduite) se composaient de 6 obusiers ou (batteries à cheval) de 6 canons légers.
De tout cet État, plus de 500 officiers et 20 000 batteries ordinaires d'artillerie de campagne et de siège opéraient en Crimée.
L'apparition de l'artillerie française jusqu'en 1860 est dictée par le règlement du 20 août 1846, avec ses modifications et précisions ultérieures. "Les troupes de l'armée de l'Est emportent avec elles un shako et une casquette", lit-on dans l'arrêté du ministre de la guerre du 28 février.
Un an plus tard, le 26 février 1855, cette décision est confirmée pour les artilleurs. En Crimée, ils portaient un shako du modèle 1846 dans un étui - c'est ainsi qu'ils agissaient sous Alma. Mais pendant le siège, les bonnets et les fez sont devenus leur coiffe. Bien que les artilleurs aient emmené des uniformes en Crimée, ils portaient en fait des vestes et des pardessus près de Sébastopol. Seuls les sous-officiers et les officiers sont restés dans leurs uniformes. Berg mentionne deux caporaux captifs, "élégamment" vêtus "du même uniforme", mais ce sont clairement des sous-officiers.
Le shako de l'artillerie était en cuir, gainé de tissu bleu foncé, de type hussard, haut de 180 mm à l'avant et 210 mm à l'arrière. La visière est ronde, peinte en vert par le bas. Galun autour du dessus (largeur 20 mm) et les chevrons triangulaires (inclinés vers le bas) sur les côtés sont écarlates, et sur chaque chevron un espace noir le divisait en deux, 19 mm de large (extérieur) et 12 mm (intérieur), respectivement.
Placée sous la cocarde (avec une boutonnière), une plaque de cuivre avait la forme de deux canons croisés (longueur 95 mm). Sous les canons, sur la bande de cuir inférieure autour du shako, se trouvait le numéro (hauteur 23 mm) du régiment ou de la compagnie. Cependant, les compagnies d'armuriers n'ont pas reçu de numéro (peut-être que la grenade a été utilisée à la place). Pompon hémisphérique, diamètre 50 mm, laine écarlate. Dans le peloton non combattant, le pompon était tricolore (rouge au milieu).
En uniforme, un sultan aux cheveux écarlates était porté au-dessus du pompon. Tous les rangs du shako étaient censés avoir un etishket écarlate, dont les kutas pendaient sur le côté gauche du revers. Une toile cirée noire a été utilisée pour fabriquer le couvercle du shako, et le numéro (hauteur 35 mm) a été appliqué avec du cinabre. Les trompettistes et musiciens ont reçu un bonnet de fourrure noir (hauteur 23 cm devant et 26 cm derrière). Sur lui, le shlyk (tous avec des lacets et une brosse) était écarlate, et le pompon et l'etishket ressemblaient à des soldats ordinaires. Le sultan, cependant, était droit, mais aussi de couleur écarlate. Les clairons (régiment de pontons et compagnies d'ouvriers et d'armuriers), cependant, au lieu d'une casquette devaient porter un shako ordinaire, qui, le 2 mai 1854, fut ordonné d'être délivré aux trompettistes avec des musiciens au lieu d'une casquette. La couleur du képi (avec une visière rectangulaire) dans l'artillerie était bleu foncé, et une palette de couleurs écarlates a été choisie pour la tuyauterie et la grenade de la bande. Tous les artilleurs avaient une mentonnière sur leur casquette. Enfin, dans l'uniforme des écuries, une casquette bleu foncé de type fez était utilisée (sans brosse ni visière).
L'uniforme dans les troupes techniques restait encore (contrairement aux autres troupes) coupe queue-de-pie, en drap bleu d'une teinte très foncée, officiellement appelé « bleu roi ». Sur le côté, il était fermé par sept boutons d'os noirci, mais ils étaient fermés par un revers (2x7 gros boutons d'uniforme). Col (hauteur 60 mm) avec découpe, et poignets avec pointe, fermés sur le côté par un petit bouton au dessus du poignet. La couleur écarlate était présente sur les passepoils du revers, du col, du bas de l'uniforme et des faux rabats de poches sur pans courts. Les poignets, les contre-épaulettes d'épaulettes écarlates et les revers (avec grenade bleu foncé) étaient également écarlates. Boutons cuivre hémisphériques de 20 mm de diamètre (revers et rabats de poches) ou 15 mm (poignets et épaules). Emblème dessus (de bas en haut) : matricule (sauf bouches d'armuriers), 2 canons croisés et grenade. La coupe de la veste du 9 juin 1853 est établie selon le modèle des fantassins. La hauteur du col (avec une découpe), selon la réglementation, était de 50 mm, mais sous l'influence de la mode, ses dimensions, ainsi que sur l'uniforme, ont été progressivement réduites. La couleur de la veste, comme d'habitude, ne différait pas de l'uniforme, elle était fermée par neuf boutons. Poignets avec un orteil, épaulettes du tissu de la veste, sur le col - valves à trois pointes écarlates.
Le pardessus dans l'artillerie n'était porté que par les fantassins - sous-officiers et soldats du régiment de pontons, compagnies d'ouvriers et d'armuriers, serviteurs de pied et batteries itinérantes. La couleur du pardessus, comme celle des ingénieurs, a été choisie bleu foncé. Coupe : deux rangées de 6 gros boutons, la distance entre les rangées était de 220 mm en haut et de 110 mm en bas. Col rabattu, hauteur 80 mm, sans aucun symbole. Il y avait des poignets droits sur les manches et des bretelles dans le dos (comme dans l'infanterie), mais il n'y avait rien sur les épaules. La méthode de port du pardessus a été choisie de manière particulière - avec un point, "sur l'uniforme, le sabre et la cartouchière, un sac à dos, il faut le prendre, placé sur le pardessus". Le manteau lui-même était utilisé par les grades équestres: sous-officiers de tous les régiments (à l'exclusion des pontonniers), cavaliers et serviteurs des batteries à cheval, cavaliers des batteries d'équitation et trompettistes des batteries à pied, à cheval et à cheval.
Il était de taille cavalerie, avec une cape, de drap bleu foncé. Le "pardessus de Crimée" dans l'artillerie ne semblait pas être utilisé, mais avec un pardessus uniforme, ils pouvaient, comme dans l'infanterie, porter un fez rouge sans pinceau (la même calotte statutaire, mais d'une couleur différente), mais avec un veste
- ceinture rouge.
Dans l'artillerie, le pantalon bleu foncé depuis 1829 est orné de chaque côté d'un liseré et de deux galons (30 mm chacun) en drap écarlate, marque de fabrique de toutes les troupes techniques jusqu'en décembre 1914. De plus, ayant devancé l'infanterie, déjà en 1841, le pantalon recevait non seulement une braguette, mais également deux poches sur les hanches. Ceux qui montaient à cheval étaient en outre cousus sur des lanières maintenues par des boutons en os. Aussi, pour les pontons, les ouvriers et les armuriers, le pantalon du bas était gainé d'une bande de lin, ou le tissu était simplement ourlé. Les grades équestres, notamment pour l'équitation, étaient également équipés d'un pantalon de cheval de type cavalerie (institué le 13 mai 1854) avec des leys en tissu et des bottes en faux cuir, qui leur étaient remis le 13 novembre de la même année. Mais en Crimée, l'ancienne version du pantalon était également activement utilisée, avec des leys entièrement en cuir noirci. Enfin, tous les grades inférieurs de l'artillerie, y compris les sous-officiers, avaient également des pantalons en lin blanc - ils (avec des bleus) peuvent être vus sur les artilleurs de la batterie de siège n ° 33 (14e batterie du 12e régiment) près de Sébastopol dans le dessin du lieutenant Moltsheim (1855 G.). Les bottes et les bottes à éperons en fer poli (sans noircissement) ou, respectivement, les bottes et les jambières des artilleurs étaient de style militaire, les gants étaient en cuir blanc.
Equipement : une douille en cuir noir (sur le couvercle se trouvent deux canons croisés, 110x45 mm, surmontés d'une grenade de 43 mm de hauteur) et un baudrier (largeur 60 mm) en peau de taureau blanc. Ceinture de sabre (pour ceux qui sont censés) : 45 mm de large, en cuir blanc, avec deux anneaux et un fermoir en forme de S avec deux médaillons (avec des symboles d'artillerie dessus) en cuivre. Dans le cas où un fantassin portait une ceinture, deux ceintures étaient remplacées par une lame de sabre-couperet. Trompettistes (ou clairons pour les pontonniers) : un harnais pour les rangs d'équitation (à pied - pour les pontonniers), un coffret (avec un couvercle coupé à trois orteils - sauf pour les clairons des compagnies d'ouvriers et d'armuriers) et un baudrier.
Le sac à dos des fantassins est un sac d'infanterie, modèle 1845, à la différence qu'il n'avait pas de compartiment pour les cartouches, et le sac à dos lui-même était plus haut et plus étroit, 350x340 mm. La couverture de l'uniforme ou du pardessus avait des ceintures en cuir blanc, ses extrémités étaient gainées de tissu bleu foncé, sans emblèmes. Le sac à dos a été modifié le 16 juillet 1854 et le 27 mars 1856 - comme dans l'infanterie de l'armée (ceintures, pardessus roulé et housse en teck).
Armement : tromblon de choc (modèle 1829 T) et sabre-hachoir de foot rangers sample 1842 - fantassins. Les rangs montés ont reçu un sabre de canonniers montés du modèle 1829 (type hussard, avec un arc sur la poignée, une lanière en cuir blanc) et un pistolet de cavalerie du modèle 1822. a reçu une ceinture ventrale pour l'artillerie de rang et de file d'infanterie, destinée à porter un sabre-couteau. Avant cela, tous les sous-officiers portaient une ceinture de grades d'équitation et un sabre d'artilleurs à cheval. De plus, leur armement comprenait un pistolet (pour les pontonniers et dans les compagnies d'ouvriers et d'armuriers - un tromblon).
Equipement du cheval (chevaux d'équitation) : premier du modèle de 1845, mais en 1853 une nouvelle version de celui-ci fut adoptée. La première option comprenait une selle, une bride et des sangles en cuir noirci, un tapis de selle en peau de mouton blanc (avec des festons écarlates le long du bord), un tapis de selle en laine blanche (carré, côté 1,40 m) et une valise bleu foncé (passepoil écarlate et grenade avec un numéro fendu aux extrémités). Depuis le 23 juin 1853, le tapis de selle est en drap bleu foncé avec passepoil écarlate, galon et grenade, les lingots sont en basane noire, et la selle est en cuir marron. Le polissage noir des étriers en fer poli a été aboli en même temps.
Le tapis de selle pour trompettistes et musiciens est resté le même, mais en peau de mouton noire.
Les insignes de grade suivants ont été utilisés. Chevrons tressés (inclinés au-dessus de la manchette) de laine écarlate ou «festonnés» d'or avec une bordure écarlate. Gunnery First Gunner ou Mounted, Pontooner, Worker ou Gunsmith 1st Class : Chevron écarlate sur chaque avant-bras. Ouvrier 2e classe (entreprises de travail) : chevron écarlate sur la manche droite uniquement. Artifices (étagères), batelier (pontons), cadres et armuriers (compagnies) : deux chevrons écarlates sur la manche droite uniquement.
Caporal, sergent et sergent principal (pontons, ouvriers et armuriers), ou brigadier, sergent-major et sergent-major principal (autres unités), et capitainearmus : comme dans la cavalerie légère.
Trompettiste ou clairon : uniquement sur l'uniforme - un galon tricolore (de losanges) autour du col, le long du haut des poignets et autour des trois boutons à l'arrière de la taille. Brigadier-trompettiste et caporal-clairon : au-dessus de la manche chevrons du grade - galon de la position. Wahmister-trompettiste et sergent-clairon: au lieu de tricolore - chevrons dorés sans bordure, et au-dessus d'eux se trouvent deux chevrons dorés «avec denticules» du wahmister senior; grenades dorées brodées sur les revers. Sur un bonnet de fourrure, un sultan droit (écarlate à la base) et un pompon (bleu au centre) sont tricolores ; le caporal et le sergent clairon avaient un shako des rangs inférieurs. Les chevrons pour long service sont écarlates (uniquement avec un uniforme).
Les Ajudans, comme les officiers, portaient un uniforme de drap fin, avec des boutons dorés (mais avec un numéro), où les revers de grenade étaient brodés d'or. Les contre-épaulettes étaient en argent avec un espace cramoisi (1 mm), et l'épaulette (sur l'épaule droite) et la contre-épaulette étaient en argent avec des rayures cramoisies (10 mm) au milieu. À partir du 9 juin 1853, les pantalons et l'équipement (un coffre avec une bretelle et une ceinture en cuir verni noir) étaient également des officiers - dans la cavalerie, cette mesure a été mise en pratique dès le 26 décembre de l'année dernière. Les shako ajudans s'appuyaient comme des soldats ordinaires, mais le galon autour du sommet était en or avec un espace cramoisi, et les chevrons, la boutonnière et l'étiquette étaient écarlates. En 1853
les chevrons sont supprimés, et la boutonnière et l'étiquette sont désormais des morceaux de laine écarlate de 50 mm de long, alternés avec des morceaux de 25 mm de long, en fil d'or. Le bonnet d'officier, la tresse horizontale est en argent, et toutes les coutures sont en tresse d'or écarlate.
L'uniforme des officiers dans toutes les parties de l'artillerie était du même modèle. Depuis le milieu des années 1850. la doublure du shako, de l'uniforme et du pantalon, selon les exigences de la mode, a progressivement commencé à changer de couleur en noir. Cependant, ces changements ne s'appliquent apparemment pas encore à la campagne de Crimée.
La hauteur du shako (officiellement - similaire au modèle des rangs inférieurs) dans les années 50. diminué. Le shako était garni d'un tissu fin. Autour du sommet du shako, il y avait un galon d'or "avec des dents", de la largeur du suivant. Sous-lieutenant : 20 mm. Lieutenant : 25 mm.
Capitaine : 30 mm. Lieutenant-colonel : argent, 35 mm (plus une tresse intérieure en or de 15 mm). Colonel : comme un lieutenant-colonel, mais les deux galons sont en or. Il n'y a pas de chevrons sur le shako de l'officier, et le numéro est remplacé par une grenade dorée (23 mm) surmontée de canons croisés. (Il n'y avait pas non plus de numéro sur la couverture du shako.) Pompon plaqué or, 50 mm, en dentelle (pour les officiers supérieurs en cordon torsadé mat).
Sultan à plumes de coq, écarlate (tricolore, bleu à la base - grades supérieurs et quartier général du régiment), le colonel a un sultan ordinaire ; étiquette doré. En campagne (y compris en Crimée), les officiers portaient un shako « en toile cirée cirée », avec un pompon. Les casquettes des officiers n'avaient pas d'emblème sur la bande et les boutons de la fausse sangle pouvaient être décorés de l'emblème du régiment. En Crimée, un bonnet ou shako, avec un uniforme, composait le costume d'un officier d'artillerie.
L'uniforme était taillé dans un tissu fin, avec des boutons dorés (pas de numéro de régiment) et des grenades brodées d'or (avec des paillettes et du fil, contrairement aux ajudans).
Les contre-chauffeurs étaient dorés (le capitaine-instructeur, le capitaine - ajudan senior et le lieutenant-colonel - argent). L'épaulette métallique instrumentale est en or, la frange des officiers subalternes et des capitaines est en or mat (or brillant dans l'infanterie).
Sous-lieutenant :
épaulettes dorées, celle de droite avec une frange. Lieutenant : or, gauche avec frange. Capitaine:
or, les deux avec des franges. Chef d'escadron : doré, sur l'épaulette droite sans frange. Principal:
vice versa. Colonel : or, frange sur les deux épaulettes. Les lieutenants (à l'École polytechnique) et les capitaines (exerçant les mêmes fonctions que les lieutenants) du 2e rang se distinguaient par une bande cramoisie au milieu de la bretelle et au champ de l'épaulette. Et des épaulettes en argent ou une tresse képi - capitaine-instructeur (avec frange dorée sur les deux épaulettes), capitaine - ajudan senior (épaulette à frange argentée) et lieutenant-colonel (frange dorée).
En septembre 1853, les lieutenants du 2e rang reçurent l'ordre de porter une seule bande de so-lieutenants sur leur casquette (au lieu de deux bandes le long du haut de la bande), mais cet ordre resta sur papier. Mais certains sous-lieutenants portaient des casquettes de lieutenant ! Cravate en satin noir, sans bordure blanche.
Dans la campagne, cependant, l'uniforme est progressivement remplacé par un semi-caftan simple boutonnage à neuf boutons, avec un col sans valves et des poignets pointus. En Crimée, au moins un officier d'artillerie du IIe Corps a fait changer son uniforme en un uniforme à simple boutonnage, enlevant le revers et remplaçant les boutons en os (ou crochets) en dessous par une rangée de boutons d'uniforme. Sous cette improvisation, il portait un gilet de Crimée ordinaire avec des boutons et une ceinture colorée sous le harnais.
Le pardessus était cousu selon le modèle des officiers de cavalerie, en tissu uniforme, 2x7 gros boutons, 10 cm de long sous les genoux. Il n'y avait pas de valves sur le col, les poignets
- une souris. Au dos du pardessus, il y avait des rabats de poche à trois pointes avec trois boutons chacun. La cape du manteau de l'officier (à qui elle était posée) était plus longue que celle des grades inférieurs; col - debout, boutonné sur des rosaces avec une tête de lion estampée; les boutons du manteau étaient recouverts de tissu. Les pantalons uniformes étaient cousus à partir de tissu uniforme (bordure et rayures écarlates), avec des lanières de cuir noir. Le règlement ne dit rien sur le pantalon de chval, les colliers et les revers du bas du pantalon étaient en tissu. Chaussures: bottes et éperons comme les soldats, ainsi que les jambières en cuir des officiers de cavalerie.
Equipement des officiers : une soutane avec un baudrier et une ceinture en cuir verni noir sous toutes les formes. Sur la fronde se trouve un dispositif doré (tête de lion et bouclier avec grenade). Gants en daim blanc. Il y avait des longes de tous les jours (toutes en cuir verni noir) et des longes de parade (soie noire avec un pompon doré), type cavalerie. Armoiries (avant le 23 août 1856) : sabre d'officier modèle 1829 et pistolets d'officier à cheval modèle 1833
Échantillon d'équipement pour chevaux 1845 :
valise et tapis de selle bleu foncé avec passepoil écarlate, galon (tapis de selle) et grenade. Depuis 1854, la grenade sur une valise et un tapis de selle a commencé à être brodée d'or, et le tapis de selle de tous les jours a été introduit, avec passepoil et galons d'un tapis de selle, mais sans aucun autre symbolisme.
En 1854, les troupes du génie se composaient de trois régiments, chacun dans la composition suivante :
une compagnie non combattante, une compagnie de sapeurs conducteurs et deux bataillons de 8 compagnies chacun (1 mineur et 7 sapeurs). Au total, un régiment du génie a participé au siège de Sébastopol.
Les mineurs et les sapeurs étaient considérés comme des soldats sélectionnés, c'est pourquoi leurs uniformes comprenaient des éléments de l'uniforme des compagnies d'élite - une moustache et une barbe, des épaulettes rouges et un sabre. L'uniforme de marche en Crimée était composé d'un shako (dans un étui en toile cirée noire) sans pompon, d'un pardessus, d'un pantalon en legging et d'une doublure avec un sac à dos, comprenant une couverture en toile blanche (avec des bordures bleues) pour un sac à cartouches.
Le shako de sapeur était gainé de soie noire (!) Tissu, le galon autour du sommet et les chevrons triangulaires (pointe vers le bas) étaient en laine écarlate. La mentonnière fermée par une boucle. Dimensions Shako : hauteur avant 170 mm, arrière - 200 mm ; la largeur de la visière est de 60 mm, la bande de cuir inférieure est de 25 mm. Sur le devant il y a un double pompon écarlate (type grenadier, 45 et 60 mm), une cocarde et une plaque de cuivre. Ce dernier était un trophée (un casque sur une cuirasse) sur une grenade (superposée sur une couronne de feuilles de chêne et de laurier et une paire d'armes à tranchant croisé - une épée et une hallebarde) avec le numéro du régiment sur la bombe. Les cavaliers du shako possédaient en outre un etishket à deux cutas, en laine écarlate, de 4,70 m de long, attaché au shako par l'arrière à l'aide d'un cordon écarlate.
Le képi du génie et de l'artillerie était entièrement bleu foncé avec des lacets écarlates et une grenade (35 mm de haut) sur la bande. La visière est rectangulaire, les cavaliers avaient également une mentonnière.
L'uniforme est resté de la coupe queue-de-pie à l'ancienne, cousue en tissu bleu foncé.
Le col (avec une découpe), le revers, les poignets à rabats étaient en velours noir avec passepoil écarlate. Les contre-chauffeurs étaient écarlates, tout comme les épaulettes (grenadier). Les planchers de l'uniforme (raccourci pour les cavaliers) à revers écarlates, décorés de grenade bleue.
Rabats de poche à trois points, verticaux, à trois boutons et passepoil écarlate.
Sur des boutons en laiton, un trophée (casque et cuirasse) dans un rebord. Insignes de grade de type infanterie, écarlate/or.
La veste (sur neuf boutons) avait un col de la couleur d'un uniforme, mais les poignets étaient droits, surmontés d'un petit bouton d'uniforme. Le pardessus, bien que de coupe d'infanterie, différait par sa couleur - bleu foncé. Sur le col (hauteur 55 mm) étaient cousus (occupant toute sa partie avant) des rabats à trois bras (largeur 30 mm) en velours noir avec passepoil écarlate sur trois côtés. Contre-épaulettes épaulettes de drap écarlate. Le pardessus du sous-officier se distinguait par l'absence de bretelles et la coupe « à la taille ». Au lieu d'un pardessus, les sapeurs-cavaliers s'appuyaient sur un manteau de cavalerie bleu foncé avec une cape. Pantalon d'un échantillon d'artillerie, avec deux bandes écarlates (largeur 30 mm) et passepoil. Comme les autres troupes de cavalerie, les cavaliers (qui portaient des bottes et des gants de cuir blanc) reçoivent le 13 novembre 1854 un nouveau modèle de pantalon de chval, avec de fausses bottes.
Cartouchière d'infanterie, mais avec une grenade en cuivre sur le couvercle. Les bretelles du sac et du sabre, cependant, dans les troupes du génie sont restées en cuir blanc. La fronde est également en cuir blanc. Les chevaux d'équitation, au contraire, s'appuyaient sur une boîte de cavalerie (avec grenade) sur une fronde blanche et une ceinture blanche (fixée sur deux plaques rondes en cuivre) pour un sabre. La valise est bleu foncé avec un passepoil écarlate et une grenade au bout (le numéro du régiment dans la bombe). Les sapeurs à pied et les mineurs portaient le même sac à dos que les sapeurs des régiments d'infanterie. Sinon, l'équipement des régiments du génie était orienté vers l'infanterie ou la cavalerie légère (montable).
Armement : sapeurs et mineurs - Mousquet Voltiger, baïonnette et sabre d'artillerie modèle 1816 (lame droite dans le style "romain"). Sous-officiers : épée 1816
sur une bretelle en cuir, et en panne - sur une ceinture en cuir laqué noir. Cavaliers sapeurs : sabre et pistolet de cavalerie légère. L'équipement de protection comprenait un casque en acier peint en noir ("pot sur la tête") et une cuirasse (avec un collier de protection), qui étaient délivrés à environ 50 pièces par compagnie. Les échantillons alors utilisés de 1833, 1836 et 1838. ne différait que par le poids - ce dernier pesait jusqu'à 20,5 kg.
Le shako de l'officier, contrairement aux soldats, pouvait être gainé non seulement de soie, mais aussi de feutre noir. Les chevrons sur les côtés et le galon supérieur étaient en or. La largeur de ce galon dépendait du grade : 25 mm (lieutenants), 30 mm (capitaine) et 35 mm (officiers supérieurs).
Le colonel et le lieutenant-colonel se distinguaient par un deuxième galon (15 mm), et le premier galon du lieutenant-colonel était en argent. Pompon comme d'habitude. De plus, les officiers supérieurs ont également un sultan tricolore et le colonel a un sultan. Sur le capuchon, l'attention a été attirée sur les galons d'or et l'absence de grenade sur la bande. L'uniforme de l'officier était coupé, comme d'habitude, dans du tissu fin, avec une grenade d'or sur les revers. Épaulettes d'infanterie, or. (Les grades du capitaine et du lieutenant du 2e rang portaient une bande de soie cramoisie au milieu de l'épaulette.) Une cravate en satin noir, des gants en coton blanc, et pour les officiers supérieurs des unités à pied et les officiers des sapeurs-chauffeurs - blanc cuir. À partir du 10 mars 1854, les officiers sont autorisés à porter un demi-caftan en tissu bleu foncé à neuf boutons en uniforme de tous les jours. Le col était ici orné de pans de velours noir à passepoil écarlate, et les parements droits étaient fermés par deux petits boutons.
Au lieu d'un pardessus, tous les officiers utilisaient un manteau bleu foncé avec une cape, dont le col était attaché avec deux insignes ronds avec des muselières de lion.
Officiers de sapeurs-cavaliers : coffre d'officier de cavalerie légère, avec une grenade dorée sur le couvercle. La ceinture d'une épée ou d'un sabre était en cuir verni noir.
Il était fermé par deux plaques dorées reproduisant le motif d'un bouton en forme. Étant en uniforme, les officiers des unités à pied utilisaient une ceinture à épée en tissu avec une lame en cuir verni pour porter une épée. Sur la valise, il y avait un passepoil écarlate et une grenade dorée, et la selle de tous les jours se distinguait par un passepoil, un galon et une grenade écarlate. Armes: une épée du modèle de l'armée de 1831, puis - un échantillon spécial de 1855, pour les ingénieurs. Grades supérieurs - un échantillon de 1831 avec un fil, et depuis 1855 - une épée d'officiers d'état-major. Tous les officiers des troupes du génie de la cavalerie - le sabre et le pistolet d'un officier de cavalerie légère, remplacés en 1855 par le sabre d'un officier supérieur d'infanterie et le pistolet d'un officier d'état-major.
Cavalerie lourde Les 6e et 9e régiments de cuirassiers opéraient en Crimée, et les 6e et 7e régiments y étaient envoyés par les régiments de dragons de l'armée française. Les deux régiments de dragons (avec le 4th Hussars) de la division se distinguèrent lors de la bataille de Kugil (près d'Evpatoria) le 29 septembre 1855. À partir du 20 avril 1854, tous les régiments de cavalerie se composaient de six escadrons.
Le casque des cuirassiers est resté du modèle 1845, en acier. Les visières avant et arrière sont en acier avec garniture en laiton. Un peigne en laiton était monté sur le dessus (la tête de Méduse était devant) et la mentonnière était gainée d'écailles en laiton. Un turban (bande) en fourrure de phoque noire couvrait également la visière avant et atteignait l'endroit où la crête était attachée au corps. Sur la crête se trouve une brosse à poils roux et une crinière de cheval noire. A gauche se trouvait un panache de plumes rouges et à la base de son pompon couleur escadron (voir fig.
ci-dessous dans la section sur les rangers). Képi : la bande est bleu foncé, la couronne et le bas sont rouges avec un passepoil bleu foncé, l'emblème sur la bande (uniquement pour les rangs inférieurs) est rouge grenade.
YUKAT.465255.019RE Equipement Arlan-1451 Manuel d'utilisation Partie I YUKAT.465255.019RE SOMMAIRE ... "RECONNAISSANCE DU DÉBITEUR EN FAILLITE (FAILLI) Effectuer une transaction par gestion concurrentielle ... "CIVIL AVIATION L.N. ELISOV, S.V. GROMOV Le document étudie les problèmes de formation sur simulateur des équipages de conduite des civils...»
"Portrait de saint Démétrius de Rostov de la collection du musée-réserve Sergiev Posad O.I. Zaritskaya Parmi les portraits des hiérarques conservés dans le musée-réserve de Sergiev Possad, se distingue une toile à l'image du prélat de Rostov Demetrius Tuptalo1. Il est peint sur toile et a des dimensions importantes d'une large toile...»
OAO Mobile Telesystems Tél. 8-800-250-0890 www.sakha.mts.ru Numéro fédéral Almaz / Mode de paiement anticipé Recevez des points bonus MTS et échangez-les contre des minutes gratuites, des SMS et d'autres récompenses (1 point = 3 roubles provenant des accumulations pour les services Internet MTS et 6 roubles du reste accumulés ... "
"UN V. Vozniuk SIGNIFICATIONS FONDAMENTALES, SCIENTIFIQUES, PHILOSOPHIQUES ET PERSONNELLES DE L'ÊTRE Sommaire Introduction Le sens dans son ensemble Correspondances isomorphes au modèle triadique de l'être Le sens comme finalité Conclusions Annexe 1. Correspondance mutuelle des principales triades existentielles Annexe 2. Principaux modèles du paradigme universel de développement Literat ... "complots. Livre Deux : Publier le Livre ; 2013 ISBN 978-1-304-58747-3 Annotation Connu dans le livre...» Autoformation – 60 heures. Tâche individuelle - 1 (travail de contrôle indépendant). Travail d'essai - 1. Recommandé ... "retour au service de tous ceux précédemment licenciés par Pavel .... "2017 www.site - "Bibliothèque électronique gratuite - divers matériaux"
Les matériaux de ce site sont affichés pour examen, tous les droits appartiennent à leurs auteurs.
Si vous n'acceptez pas que votre matériel soit publié sur ce site, veuillez nous écrire, nous le supprimerons dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables.
Le fantassin de l'armée impériale russe en 1914 n'était en aucun cas inférieur à ses alliés ou adversaires en termes de degré d'équipement et d'armes. Oui, ils avaient leurs propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Mais dire que notre infanterie est inférieure en tout à l'infanterie allemande ou française est pour le moins stupide. Pourquoi?
Par exemple, l'uniforme français de cette période ne contribuait pas au camouflage du personnel. Dans le même temps, l'une des principales innovations de l'armée russe avant la Première Guerre mondiale est l'introduction en 1907 d'un nouvel uniforme de campagne en kaki, une teinte vert olive clair.
Certes, cette forme, après de nombreux lavages et décolorations, est devenue presque blanche (comme le camarade Sukhov du film "White Sun of the Desert"). C'est l'héritage de la guerre russo-japonaise, dont nous avons tenu compte, et nos alliés, qui en 1909-1911 ont également développé divers types d'uniformes kaki (uniforme Boer, uniforme Reseda, uniforme Detail), n'ont pas pu réaliser leurs évolutions.
Malgré toute l'apparente simplicité et légèreté, l'uniforme et l'équipement du fantassin de l'armée tsariste ont été conçus et fabriqués correctement avec l'arrangement.
En 1907, un nouvel uniforme a été introduit pour tous les grades et branches de service.
Il comprenait une tunique (en coton pour l'été et en tissu de laine pour l'hiver), un bloomer, des bottes à hauteur du genou et une casquette à visière.
Les bloomers étaient cousus dans l'espoir de les porter rentrés dans des bottes hautes. Ils étaient de couleur «royale» vert foncé pour l'infanterie et les autres troupes à pied.
Sur le terrain, les plus pratiques étaient les bloomers kaki, qui ont reçu une reconnaissance universelle pendant les années de guerre.
Jusqu'en 1912, les soldats et les sous-officiers recevaient un uniforme d'officier presque identique, mais sans poches extérieures. La gymnaste était universelle, son ancêtre était la chemise-kosovorotka paysanne russe.
La forme était complétée par des bottes hautes et une casquette sans sangle.
Par temps frais, le personnel était vêtu de pardessus, de chapeaux en peau de mouton naturelle ou de fourrure artificielle d'astrakan et d'une cagoule.
Les officiers portaient des manteaux de tissu gris-bleu, d'autres grades - des pardessus de laine grossière gris-brun. Les pardessus étaient à double boutonnage, avec des cols rabattus, fixés sur le côté droit avec des crochets et des boucles.
Pour les fantassins, les pardessus atteignaient le milieu du bas de la jambe, avec une longue fente à l'arrière, grâce à laquelle il était possible de rentrer les planchers de pardessus par mauvais temps. Des rabats colorés (boutons) étaient cousus sur des pardessus et des manteaux, dans certaines parties - avec des passepoils colorés, indiquant le régiment et le type de troupes. Comme les capotes étaient grandes, elles avaient une sangle spéciale à l'arrière pour s'adapter. Par la suite, dans des conditions de combat, les officiers ont commencé à passer aux pardessus de soldat afin d'attirer moins l'attention sur leur personne.
Les casquettes avec visière étaient pour la plupart kaki, la visière était repeinte en vert dans les conditions avant. La couleur principale du groupe était le vert.
Dans les gardes et chez les grenadiers, la bande pouvait avoir la couleur rouge, bleue, blanche ou vert foncé. Devant, au centre, une cocarde estampée était attachée à la bande. Elle avait trois types - pour les officiers, les sous-officiers et les soldats. Les couleurs peuvent être : orange, noir et blanc. Les miliciens portaient une « croix de milice » sur la cocarde. Des cocardes étaient également attachées aux chapeaux.
L'équipement de marche total d'un fantassin en 1914 comprenait les éléments suivants :
1. Chapeau avec une cocarde ;
2. Chapeau avec une cocarde ;
3. Bashlyk;
4. Échantillon de chemise en tissu de camping (tunique) 1912;
5. Ensemble de sous-vêtements ;
6. Échantillon de sarouel en tissu d'infanterie 1912 ;
7. Un pardessus du modèle 1907 avec des bretelles et des boutonnières vert foncé (en rouleau, il pouvait faire office de gilet pare-balles, en tout cas, il était tout à fait possible d'arrêter un fragment à la fin);
8. Bottes ;
9. Chaussons.

RIA privé 1914. Reconstruction.
Équipement:
1. Echantillon de sac polochon 1910 (ou 1914 selon le type d'échantillon de sac 1869 pour les bataillons linéaires du Turkestan) ou cartable ;
2. Ceinture avec un badge ;
3. Ceinture de pantalon ;
4. Ceinture pour rouler;
5. Deux cartouchières en cuir (ou en bois) (en 1915, pour économiser de l'argent, ils ont commencé à en émettre une);
6. Flacon en aluminium (ou en verre) avec étui de transport ;
7. Sac de sucre ;
8. Quilleur ;
9. Bandoulière de poitrine pour 30 cartouches (cuir en 1914, puis chiffon);
10. Sac de munitions de rechange ;
11. Tente de camping (partie);
12. Demi-rack pour une tente avec un piquet et une corde;
13. Un couvercle pour une pelle et une pelle (petite pelle de sapeur de Linnemann ou grande pelle de sapeur);
14. Baïonnette avec suspension en cuir ;
La cartouchière de poitrine, comme le pardessus du rouleau, était suspendue sur l'épaule gauche. Le pardessus, comme déjà mentionné ci-dessus, pouvait servir de protection, et la cartouchière facilitait également le rechargement et laissait l'épaule droite libre pour la crosse du fusil (il était entendu que la majorité dans l'armée était droitière).
Le sac à pain peut être suspendu à gauche et à droite. Une ration sèche et une partie de la charge de munitions (cartouches en vrac) y rentrent.
Les articles d'hygiène personnelle, les vêtements de rechange et le matériel de nettoyage ont été placés dans un sac de sport ou une sacoche. Une casquette, un chapeau melon et 1/6 de la tente et des piquets étaient attachés au pardessus roulé en rouleau.
Au total, environ 26 kg étaient attachés au chasseur. équipement. Les munitions étaient de 80 à 120 cartouches. Et plus tard, plus. Les munitions sont une telle chose qui est toujours en pénurie, alors les combattants ont essayé d'en emporter autant que possible avec eux.




Matériel de camping d'un soldat de la RIA, 1914


Compagnie privée de sapeurs serfs de la forteresse de Brest-Litovsk, 1914


Une partie des munitions devait être achetée à leurs frais. Cela s'applique, par exemple, aux armes de service ou aux jumelles. Les sacs à dos des officiers étaient généralement transportés dans le train de wagons. Si l'officier était à cheval, le pardessus était attaché à la selle.
Par la suite, au cours de la guerre, les équipements ont changé. Quelque part, ils sont allés sur la voie de la simplification, fabriquant, par exemple, des cartouchières en chiffon, quelque part avant que l'équipement ne soit ajouté, comme le casque d'Adrian. En tout cas, l'armée russe n'était pas étrangère aux innovations techniques et d'armes, mais nous en reparlerons la prochaine fois.
Nous exprimons notre profonde gratitude au club historique militaire "Frontier" de la ville de Brest et personnellement à Andrey Voroby pour les consultations et le matériel fourni.
Sources:
N. Armée russe de Cornouailles 1914-1918
Archives VIC "Rubezh", Brest
Nord, Jonathan.
H82 Soldats de la Première Guerre mondiale 1914-1918. Uniforme, insigne,équipement et armes / Jonathan North; [par. de l'anglais. M. Vitebsky]. —Moscou : Eksmo, 2015. - 256 p.ISBN 978-5-699-79545-1
"Soldats de la Première Guerre mondiale" - une encyclopédie complète de l'histoire des uniformes militaireset l'équipement des armées qui ont combattu sur les fronts de la "Grande Guerre". Sur ses pagesles uniformes non seulement des principaux pays de l'Entente et de la Triple Alliance sont présentés(Angleterre, France, Russie, Allemagne et Autriche-Hongrie), mais en général tous les paysempêtré dans ce terrible conflit.
Généraux et officiers d'état-major de la RIA. Jonathan du Nord.
Généraux et officiers d'état-major britanniques. Jonathan du Nord.
Garde RIA. Jonathan du Nord.
Garde britannique.North Jonathan.
Infanterie d'élite, infanterie RIA. Jonathan du Nord.
Infanterie britannique. Front occidental. Jonathan du Nord.
Cavalerie RIA. Jonathan du Nord.
Cosaques et parties étrangères de la RIA. Jonathan du Nord.
cavalerie française. Jonathan du Nord.
cavalerie britannique. Jonathan du Nord.
cavalerie allemande. Jonathan du Nord.
RIA d'artillerie. Jonathan du Nord.
Artillerie britannique
aviation britannique
Troupes techniques RIA. Jonathan du Nord.
États - participants à la Grande Guerre. Jonathan du Nord.
Toutes les publications du livre de North Jonathan
COSAQUES ET ETRANGERS
Élément clé de l'armée russe pendant 300 ans, les cosaques étaient considérés comme de bons éclaireurs et tireurs.
Troupes cosaques
De nombreux cosaques ont servi dans la garde impériale russe. Cependant, traditionnellement, les cosaques étaient regroupés en régiments géographiquement liés au Caucase (troupes du Kouban et du Terek) ou aux régions steppiques (troupes de l'Amour, d'Astrakhan, du Don, d'Orenbourg, de Semirechensk, de Sibérie, du Transbaïkal, de l'Oural et de l'Oussouri). Les unités de cavalerie ingouche, du Daghestan, tchétchène et circassienne étaient également d'origine caucasienne, mais elles n'avaient rien à voir avec les cosaques.
En temps de paix, des régiments ont été formés parmi les cosaques indigènes d'âge militaire, d'autres pendant la guerre pourraient être enrôlés dans des régiments des deuxième et troisième étapes et des centaines d'individus, utilisés principalement pour le service d'escorte. L'ère des uniformes cosaques brillants était pratiquement révolue et, en 1914, la majorité des cosaques portaient des uniformes très similaires à ceux des dragons. Mais même maintenant, ils préféraient le plus souvent des pantalons bleus très spacieux, en hiver - des capes de fourrure (manteaux) et des capuches, ainsi que des bandoulières supplémentaires et des ceintures de composition - bref, quelque chose qui pourrait souligner leur identité cosaque. Aux chaussures, les cosaques préféraient les bottes sans éperons. Les Cosaques du Caucase se distinguaient quelque peu par le fait qu'ils se rasaient la tête chauve (mais beaucoup avaient d'énormes moustaches en même temps) et portaient toujours des Circassiens noirs ou gris et des chapeaux d'astrakan. Les cosaques enroulaient souvent des cartouchières sur la ceinture. Les représentants des troupes cosaques différaient également par la couleur des bords des bretelles et des rayures. Les cosaques du Kouban avaient un passepoil rouge sur les bretelles (pour les officiers) et des rayures (sur les bretelles, après le numéro de régiment, son abréviation suivait); chez les cosaques de Terek, les bords des bretelles étaient bleu clair (l'abréviation du régiment était également placée sur les bretelles). Les épaulettes des officiers étaient recouvertes de galon d'argent. La couleur des liserés et des rayures des troupes cosaques des régions steppiques est indiquée dans le tableau de la page 145.
Sur les bretelles des «cosaques des steppes», pour faciliter l'identification, une lettre était souvent située après le numéro de régiment. Par exemple, sur les bretelles de l'armée cosaque d'Orenbourg, il y avait la lettre «O», l'armée cosaque du Don (depuis 1915) - la lettre «D», l'armée cosaque de l'Amour - la lettre «A»,
L'armée cosaque de Sibérie - les lettres "Sb" et l'armée cosaque du Trans-Baïkal - les lettres "Zb". Les cosaques des troupes caucasiennes, en règle générale, ne portaient pas de pardessus, leur préférant les manteaux (manteaux en peau de mouton ou de chèvre). Les pardessus avaient des boutonnières de la même couleur que les rayures sur les pantalons.
Les bretelles des officiers des unités d'artillerie cosaques avaient un passepoil rouge et étaient doublées de galon d'or. Des boutonnières noires à liseré rouge étaient cousues sur le col du pardessus.
Dans le cadre de l'armée cosaque du Kouban, plusieurs unités à pied ont été formées, qui ont reçu les mêmes uniformes que les montées, à l'exception des pantalons de protection.
Couleur.
Les cosaques étaient armés de fusils cosaques (une modification du fusil Mosin), de dames (une arme familiale transmise de génération en génération) et de poignards, ainsi que de piques (cosaques ordinaires des troupes cosaques "des steppes": un quart des régiment - ces cosaques qui se tenaient en première ligne étaient armés de piques). Les cosaques utilisaient leurs propres chevaux, la plupart des équipements et des uniformes.
Unités hippiques étrangères
Les régiments de chevaux formés dans le Caucase étaient généralement composés de volontaires vêtus de divers costumes nationaux. La plupart des coureurs portaient du noir,
manteaux circassiens gris ou marron clair, beshmets brillants et chapeaux d'astrakan. Les unités de cavalerie caucasiennes différaient par la couleur des bretelles et des capuchons. Les Tchétchènes, les Daghestanais et les Kabardes avaient des bretelles bleu clair, tandis que les Circassiens, les Ingouches et les Tatars en avaient des rouges. Les soldats des régiments de cavalerie étrangers portaient également des cagoules garnies d'un galon blanc. Les Tchétchènes portaient des cagoules jaunes, des blanches - Circassiens et Kabardes, des rouges - Dagestanis et Tatars, des bleu clair - Ingouches. Parfois, les Caucasiens portaient un sarouel gris-bleu, mais le plus souvent, ils préféraient des éléments du national
vêtements. L'uniforme d'officier dans ses principales caractéristiques ne différait pas de l'uniforme des régiments cosaques du Caucase.
Lire aussi
Les uniformes militaires en Russie, comme dans d'autres pays, sont apparus plus tôt que tous les autres. Les principales exigences auxquelles ils devaient satisfaire étaient la commodité fonctionnelle, l'uniformité dans les branches et les types de troupes, une nette différence avec les armées des autres pays. L'attitude envers l'uniforme militaire en Russie a toujours été très intéressée et même aimante. L'uniforme rappelait les prouesses militaires, l'honneur et le sens élevé de la camaraderie militaire. On croyait que l'uniforme militaire était le plus élégant et le plus attrayant
Non seulement les documents historiques, mais aussi les œuvres d'art qui nous ramènent au passé pré-révolutionnaire sont remplis d'exemples de la relation entre les militaires de différents grades. L'incompréhension d'une seule gradation n'empêche pas le lecteur d'isoler le thème principal de l'ouvrage, cependant, tôt ou tard, il faut réfléchir à la différence entre les adresses Votre Honneur et Votre Excellence. Peu de gens remarquent que dans l'armée de l'URSS l'appel n'a pas été aboli, il n'a été remplacé que par un seul pour tous
Le gorgerin est une plaque métallique en forme de croissant d'environ 20x12 cm, suspendue horizontalement par les extrémités sur la poitrine de l'officier près de la gorge. Conçu pour déterminer le grade d'un officier. Plus souvent dans la littérature, il est appelé insigne d'officier, insigne de cou, insigne d'officier. Cependant, le nom correct de cet élément de vêtements militaires est gorget. Dans certaines publications, notamment dans le livre A. Kuznetsov Awards, le gorgerin est considéré à tort comme un signe de récompense collective. Cependant, cela
Jusqu'au 6 avril 1834, elles s'appelaient des compagnies. Janvier 1827, 1 jour - Sur les épaulettes d'officier, pour distinguer les grades, des étoiles forgées ont été installées, comme à l'époque introduites dans les troupes régulières 23. 10 juillet 1827 - Dans les compagnies d'artillerie à cheval du Don, des pompons ronds sont installés aux rangs inférieurs de laine rouge, les officiers portent les dessins en argent 1121 et 1122 24 . 1829 7 jours d'août - Des épaulettes sur les uniformes d'officiers sont installées avec un champ écailleux, suivant le modèle
Un document concernant les vêtements de l'armée, déposé par le maréchal prince Grigory Potemkin-Tavrichesky au nom du plus haut nom en 1782 en ce qui concerne sa prospérité, il s'est alourdi d'une armure de fer de protection, une telle protection s'étendant même aux chevaux; puis, entreprenant de longs voyages et formant des escadrons, ils commencèrent à s'alléger ; l'armure complète se changea en demi et
Espanton protazan, hallebarde Espanton, protazan partisan, hallebarde sont en fait des armes anciennes de type perche. L'espanton et les armes percées sont perçantes, et la hallebarde est perçante et coupante. À la fin du XVIIe siècle, avec le développement des armes à feu, elles étaient toutes désespérément dépassées. Il est difficile de dire par quoi Pierre Ier a été guidé lors de la mise en service de ces antiquités avec des sous-officiers et des officiers d'infanterie de l'armée russe nouvellement créée. Très probablement sur le modèle des armées occidentales. En tant qu'armes, ils ne jouaient aucun rôle,
L'habillement du personnel militaire est établi par des décrets, des ordonnances, des règles ou des actes normatifs spéciaux. Le port d'un uniforme naval d'un uniforme naval est obligatoire pour le personnel militaire des forces armées de l'État et des autres formations où le service militaire est fourni. Dans les forces armées russes, il existe un certain nombre d'accessoires qui figuraient dans l'uniforme naval de l'époque de l'Empire russe. Ceux-ci incluent des bretelles, des bottes, de longs pardessus avec des boutonnières.
Continuité et innovation dans l'héraldique militaire moderne Le premier signe héraldique militaire officiel est l'emblème des Forces armées de la Fédération de Russie créé le 27 janvier 1997 par décret du président de la Fédération de Russie sous la forme d'un aigle bicéphale doré aux ailes déployées, tenant une épée dans ses pattes, comme le symbole le plus courant de la défense armée de la patrie, et une couronne est un symbole d'une importance, d'une signification et d'un honneur particuliers du travail militaire. Cet emblème a été établi pour marquer l'appartenance
En Russie, le nom du tsar Pierre Ier est associé à de nombreuses réformes et transformations qui ont radicalement changé la structure patriarcale de la société civile. Les perruques ont remplacé les barbes, les chaussures et les cuissardes ont remplacé les chaussures et les bottes de raphia, les caftans ont cédé la place aux robes européennes. L'armée russe, également sous Pierre Ier, ne s'est pas écartée et est progressivement passée au système d'équipement européen. L'uniforme militaire est l'un des principaux éléments de l'uniforme. Chaque branche de l'armée reçoit son propre uniforme,
Compte tenu de toutes les étapes de la création des forces armées russes, il est nécessaire de plonger profondément dans l'histoire, et bien qu'à l'époque des principautés on ne parle pas de l'empire russe, et encore plus de l'armée régulière, l'émergence d'une chose telle que la capacité de défense commence précisément à partir de cette époque. Au XIIIe siècle, la Russie était représentée par des principautés distinctes. Bien que leurs escouades militaires soient armées d'épées, de haches, de lances, de sabres et d'arcs, elles ne pouvaient pas servir de défense fiable contre les empiètements étrangers. Armée unie
Officiers des troupes cosaques, qui relèvent du bureau du ministère militaire, en grande tenue et uniformes de fête. 7 mai 1869. Uniforme de marche du Life Guards Cossack Regiment. 30 septembre 1867. Généraux dans l'armée Unités cosaques en grande tenue. 18 mars 1855 Adjudant général, inscrit dans les unités cosaques en grande tenue. 18 mars 1855 Aile d'adjudant, répertoriée dans les unités cosaques en grande tenue. 18 mars 1855 Officiers en chef
 L'accession au trône de l'empereur Alexandre Ier a été marquée par un changement d'uniforme de l'armée russe. Le nouvel uniforme combinait les tendances de la mode et les traditions du règne de Catherine. Les soldats vêtus d'uniformes de style queue de pie avec des cols hauts, des bottes ont remplacé tous les grades par des bottes. Les Jaegers de l'infanterie légère recevaient des chapeaux à bord rappelant les hauts-de-forme civils. Un détail caractéristique des nouveaux uniformes des fantassins lourds était un casque en cuir à plumes hautes.
L'accession au trône de l'empereur Alexandre Ier a été marquée par un changement d'uniforme de l'armée russe. Le nouvel uniforme combinait les tendances de la mode et les traditions du règne de Catherine. Les soldats vêtus d'uniformes de style queue de pie avec des cols hauts, des bottes ont remplacé tous les grades par des bottes. Les Jaegers de l'infanterie légère recevaient des chapeaux à bord rappelant les hauts-de-forme civils. Un détail caractéristique des nouveaux uniformes des fantassins lourds était un casque en cuir à plumes hautes.
Ils n'émettent pas un rugissement guerrier, ils ne scintillent pas avec une surface polie, ils ne sont pas décorés d'armoiries et de panaches ciselés, et bien souvent ils sont généralement cachés sous des vestes. Or, aujourd'hui, sans cette armure, d'apparence disgracieuse, il est tout simplement impensable d'envoyer des soldats au combat ou d'assurer la sécurité des VIP. Le gilet pare-balles est un vêtement qui empêche les balles de pénétrer dans le corps et protège donc une personne contre les tirs. Il est fabriqué à partir de matériaux qui dispersent
Les bretelles de l'armée tsariste de 1914 sont rarement mentionnées dans les longs métrages et les livres historiques. Pendant ce temps, c'est un objet d'étude intéressant à l'époque impériale, sous le règne du tsar Nicolas II, les uniformes étaient un objet d'art. Avant le début de la Première Guerre mondiale, les signes distinctifs de l'armée russe différaient considérablement de ceux qui sont utilisés aujourd'hui. Ils étaient plus lumineux et contenaient plus d'informations, mais en même temps ils n'avaient pas de fonctionnalité et étaient facilement visibles sur le terrain.
Très souvent dans le cinéma et la littérature classique, il y a le titre de lieutenant. Maintenant, il n'y a pas un tel grade dans l'armée russe, tant de gens s'intéressent au lieutenant, quel est le grade conformément aux réalités modernes. Pour comprendre cela, il faut se pencher sur l'histoire. L'histoire de l'apparition du grade Un tel grade de lieutenant existe toujours dans l'armée d'autres États, mais il n'existe pas dans l'armée de la Fédération de Russie. Il a été adopté pour la première fois au XVIIe siècle dans les régiments amenés au standard européen.
 L'EMPEREUR, le 22 février et le 27 octobre de cette année, le plus haut commandement a daigné 1. Généraux, quartiers généraux et officiers supérieurs et grades inférieurs de toutes les troupes cosaques, à l'exception des Caucasiens, et à l'exception des Gardes unités cosaques, ainsi que des fonctionnaires civils, consistant dans le service dans les troupes cosaques et dans les conseils et administrations régionaux au service des régions de Kouban et Terek, nommés aux articles 1 à 8 de la liste ci-jointe, annexe 1, à avoir un uniforme selon le ci-joint
L'EMPEREUR, le 22 février et le 27 octobre de cette année, le plus haut commandement a daigné 1. Généraux, quartiers généraux et officiers supérieurs et grades inférieurs de toutes les troupes cosaques, à l'exception des Caucasiens, et à l'exception des Gardes unités cosaques, ainsi que des fonctionnaires civils, consistant dans le service dans les troupes cosaques et dans les conseils et administrations régionaux au service des régions de Kouban et Terek, nommés aux articles 1 à 8 de la liste ci-jointe, annexe 1, à avoir un uniforme selon le ci-joint
 L'armée est l'organisation armée de l'État. Par conséquent, la principale différence entre l'armée et les autres organisations étatiques est qu'elle est armée, c'est-à-dire que pour remplir ses fonctions, elle dispose d'un complexe de différents types d'armes et de moyens qui garantissent leur utilisation. En 1812, l'armée russe était armée d'armes froides et d'armes à feu, ainsi que d'armes de protection. Aux armes blanches dont l'utilisation au combat n'est pas liée à l'utilisation d'explosifs pour la période sous revue -
L'armée est l'organisation armée de l'État. Par conséquent, la principale différence entre l'armée et les autres organisations étatiques est qu'elle est armée, c'est-à-dire que pour remplir ses fonctions, elle dispose d'un complexe de différents types d'armes et de moyens qui garantissent leur utilisation. En 1812, l'armée russe était armée d'armes froides et d'armes à feu, ainsi que d'armes de protection. Aux armes blanches dont l'utilisation au combat n'est pas liée à l'utilisation d'explosifs pour la période sous revue -
 Presque tous les pays d'Europe ont été entraînés dans les guerres de conquête, qui ont été continuellement menées par l'empereur de France Napoléon Bonaparte au début du siècle dernier. Dans la période historiquement courte de 1801-1812, il réussit à soumettre la quasi-totalité de l'Europe occidentale à son influence, mais cela ne lui suffit pas. L'empereur de France a revendiqué la domination mondiale et la Russie est devenue le principal obstacle sur son chemin vers le sommet de la gloire mondiale. Dans cinq ans je serai le maître du monde, déclara-t-il dans un élan ambitieux,
Presque tous les pays d'Europe ont été entraînés dans les guerres de conquête, qui ont été continuellement menées par l'empereur de France Napoléon Bonaparte au début du siècle dernier. Dans la période historiquement courte de 1801-1812, il réussit à soumettre la quasi-totalité de l'Europe occidentale à son influence, mais cela ne lui suffit pas. L'empereur de France a revendiqué la domination mondiale et la Russie est devenue le principal obstacle sur son chemin vers le sommet de la gloire mondiale. Dans cinq ans je serai le maître du monde, déclara-t-il dans un élan ambitieux,
 107 régiments cosaques et 2,5 compagnies d'artillerie à cheval cosaques ont participé à la guerre patriotique de 1812. Ils constituaient des perquisitions irrégulières, c'est-à-dire une partie des forces armées qui n'avaient pas d'organisation permanente et différaient des formations militaires régulières par le recrutement, le service, la formation et les uniformes. Les cosaques étaient un domaine militaire spécial, qui comprenait la population de certains territoires de la Russie, qui constituaient l'armée cosaque correspondante du Don, de l'Oural, d'Orenbourg,
107 régiments cosaques et 2,5 compagnies d'artillerie à cheval cosaques ont participé à la guerre patriotique de 1812. Ils constituaient des perquisitions irrégulières, c'est-à-dire une partie des forces armées qui n'avaient pas d'organisation permanente et différaient des formations militaires régulières par le recrutement, le service, la formation et les uniformes. Les cosaques étaient un domaine militaire spécial, qui comprenait la population de certains territoires de la Russie, qui constituaient l'armée cosaque correspondante du Don, de l'Oural, d'Orenbourg,
 L'armée russe, qui détient l'honneur de la victoire sur les hordes napoléoniennes dans la guerre patriotique de 1812, se composait de plusieurs types de forces armées et de branches militaires. Les types de forces armées comprenaient les forces terrestres et la marine. Les forces terrestres comprenaient plusieurs branches de l'armée, de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et des pionniers, ou du génie aujourd'hui sapeurs. Les troupes d'invasion de Napoléon sur les frontières occidentales de la Russie furent combattues par 3 armées russes du 1er Ouest sous le commandement
L'armée russe, qui détient l'honneur de la victoire sur les hordes napoléoniennes dans la guerre patriotique de 1812, se composait de plusieurs types de forces armées et de branches militaires. Les types de forces armées comprenaient les forces terrestres et la marine. Les forces terrestres comprenaient plusieurs branches de l'armée, de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et des pionniers, ou du génie aujourd'hui sapeurs. Les troupes d'invasion de Napoléon sur les frontières occidentales de la Russie furent combattues par 3 armées russes du 1er Ouest sous le commandement
Sous le règne d'Alexandre III, il n'y a pas eu de guerres ni de batailles majeures. Toutes les décisions de politique étrangère étaient prises personnellement par le Souverain. Le poste de chancelier d'État a même été supprimé. En politique étrangère, Alexandre III s'est orienté vers le rapprochement avec la France et, dans la construction de l'armée, une grande attention a été accordée à la recréation de la puissance navale de la Russie. L'empereur a compris que l'absence d'une flotte forte avait privé la Russie d'une partie importante de son poids de grande puissance. Sous son règne, les fondations ont été posées
 La science des armes russes anciennes a une longue tradition; elle est née du moment de la découverte en 1808 sur le site de la célèbre bataille de Lipitsk en 1216, d'un casque et d'une cotte de mailles, appartenant peut-être au prince Yaroslav Vsevolodovich. Les historiens et experts dans l'étude des armes anciennes du siècle dernier A. V. Viskovatov, E. E. Lenz, P. I. Savvaitov, N. E. Brandenburg attachaient une importance considérable à la collecte et à la classification des équipements militaires. Ils ont également commencé le décodage et sa terminologie, y compris -. cou
La science des armes russes anciennes a une longue tradition; elle est née du moment de la découverte en 1808 sur le site de la célèbre bataille de Lipitsk en 1216, d'un casque et d'une cotte de mailles, appartenant peut-être au prince Yaroslav Vsevolodovich. Les historiens et experts dans l'étude des armes anciennes du siècle dernier A. V. Viskovatov, E. E. Lenz, P. I. Savvaitov, N. E. Brandenburg attachaient une importance considérable à la collecte et à la classification des équipements militaires. Ils ont également commencé le décodage et sa terminologie, y compris -. cou
 Un uniforme militaire n'est pas seulement un vêtement censé être confortable, durable, pratique et suffisamment léger pour qu'une personne portant les épreuves du service militaire soit protégée de manière fiable contre les vicissitudes du temps et du climat, mais aussi une sorte de carte de visite de n'importe quel armée. Depuis l'apparition de l'uniforme en Europe au XVIIe siècle, le rôle représentatif de l'uniforme a été très élevé. L'uniforme d'autrefois parlait du rang de son porteur et du type de troupes auquel il appartenait, ou même
Un uniforme militaire n'est pas seulement un vêtement censé être confortable, durable, pratique et suffisamment léger pour qu'une personne portant les épreuves du service militaire soit protégée de manière fiable contre les vicissitudes du temps et du climat, mais aussi une sorte de carte de visite de n'importe quel armée. Depuis l'apparition de l'uniforme en Europe au XVIIe siècle, le rôle représentatif de l'uniforme a été très élevé. L'uniforme d'autrefois parlait du rang de son porteur et du type de troupes auquel il appartenait, ou même
Le propre convoi de Sa Majesté Impériale était la formation de la garde russe, qui assurait la protection de la personne royale. Le noyau principal du convoi était constitué des cosaques des troupes de Terek et des cosaques du Kouban. Circassiens, Nogays, Stavropol Turkmens, d'autres alpinistes musulmans du Caucase, des Azerbaïdjanais, une équipe de musulmans, à partir de 1857, le quatrième peloton des Life Guards de l'escadron du Caucase, des Géorgiens, des Tatars de Crimée et d'autres nationalités de l'Empire russe ont également servi dans le convoi. La date officielle de la fondation du convoi
 De l'auteur. Cet article propose une brève excursion dans l'histoire de l'émergence et du développement des uniformes de l'armée cosaque sibérienne. La forme cosaque de l'ère du règne de Nicolas II, la forme sous laquelle l'armée cosaque sibérienne est entrée dans l'histoire, est examinée plus en détail. Le matériel est destiné aux historiens-uniformistes novices, aux reconstitueurs historiques militaires et aux cosaques sibériens modernes. Sur la photo de gauche se trouve le signe militaire de l'armée cosaque sibérienne
De l'auteur. Cet article propose une brève excursion dans l'histoire de l'émergence et du développement des uniformes de l'armée cosaque sibérienne. La forme cosaque de l'ère du règne de Nicolas II, la forme sous laquelle l'armée cosaque sibérienne est entrée dans l'histoire, est examinée plus en détail. Le matériel est destiné aux historiens-uniformistes novices, aux reconstitueurs historiques militaires et aux cosaques sibériens modernes. Sur la photo de gauche se trouve le signe militaire de l'armée cosaque sibérienne
L'uniforme des hussards de l'armée de l'armée impériale russe de 1741 à 1788, l'armée n'avait guère besoin de cavalerie légère régulière. Les premières unités officielles de hussards de l'armée russe sont apparues sous le règne de l'impératrice
 L'uniforme des hussards de l'armée de l'armée impériale russe de 1796-1801 Dans l'article précédent, nous avons parlé de l'uniforme des hussards de l'armée russe sous le règne des impératrices Elizabeth Petrovna et Catherine II de 1741 à 1788. Après que Paul Ier est monté sur le trône, il a relancé les régiments de hussards de l'armée, mais a introduit des motifs prussiens-Gatchina dans leurs uniformes. De plus, à partir du 29 novembre 1796, les noms des régiments de hussards devinrent l'ancien nom par le nom de leur chef
L'uniforme des hussards de l'armée de l'armée impériale russe de 1796-1801 Dans l'article précédent, nous avons parlé de l'uniforme des hussards de l'armée russe sous le règne des impératrices Elizabeth Petrovna et Catherine II de 1741 à 1788. Après que Paul Ier est monté sur le trône, il a relancé les régiments de hussards de l'armée, mais a introduit des motifs prussiens-Gatchina dans leurs uniformes. De plus, à partir du 29 novembre 1796, les noms des régiments de hussards devinrent l'ancien nom par le nom de leur chef
L'uniforme des hussards de l'armée impériale russe de 1801-1825 Dans les deux articles précédents, nous avons parlé de l'uniforme des hussards de l'armée russe de 1741-1788 et 1796-1801. Dans cet article, nous parlerons de l'uniforme de hussards du règne de l'empereur Alexandre Ier. Alors, commençons ... Le 31 mars 1801, tous les régiments de hussards de la cavalerie de l'armée reçurent les noms suivants: régiment de hussards, nouveau nom Melissino
Uniforme des hussards de l'armée impériale russe de 1826-1855 Nous poursuivons la série d'articles sur l'uniforme des régiments de hussards de l'armée russe. Dans des articles précédents, nous avons passé en revue les uniformes de hussards de 1741-1788, 1796-1801 et 1801-1825. Dans cet article, nous parlerons des changements survenus sous le règne de l'empereur Nicolas Ier. En 1826-1854, les régiments de hussards suivants ont été renommés, créés ou dissous.
 Uniforme des hussards de l'armée impériale russe de 1855-1882 Nous continuons la série d'articles sur l'uniforme des régiments de hussards de l'armée russe. Dans les articles précédents, nous nous sommes familiarisés avec l'uniforme de hussard de 1741-1788, 1796-1801, 1801-1825 et 1826-1855. Dans cet article, nous parlerons des changements dans l'uniforme des hussards russes qui ont eu lieu sous le règne des empereurs Alexandre II et Alexandre III. Le 7 mai 1855, les modifications suivantes ont été apportées à l'uniforme des officiers des hussards de l'armée
Uniforme des hussards de l'armée impériale russe de 1855-1882 Nous continuons la série d'articles sur l'uniforme des régiments de hussards de l'armée russe. Dans les articles précédents, nous nous sommes familiarisés avec l'uniforme de hussard de 1741-1788, 1796-1801, 1801-1825 et 1826-1855. Dans cet article, nous parlerons des changements dans l'uniforme des hussards russes qui ont eu lieu sous le règne des empereurs Alexandre II et Alexandre III. Le 7 mai 1855, les modifications suivantes ont été apportées à l'uniforme des officiers des hussards de l'armée
 L'uniforme des hussards de l'armée impériale russe de 1907-1918 Nous terminons une série d'articles sur l'uniforme des hussards de l'armée russe de 1741-1788, 1796-1801, 1801-1825, 1826-1855 et 1855-1882. Dans le dernier article du cycle, nous parlerons de l'uniforme des hussards de l'armée restaurés sous le règne de Nicolas II. De 1882 à 1907, il n'y avait que deux régiments de hussards dans l'Empire russe, à la fois dans la garde impériale des gardes du corps, le régiment de hussards de Sa Majesté et les gardes du corps de Grodno.
L'uniforme des hussards de l'armée impériale russe de 1907-1918 Nous terminons une série d'articles sur l'uniforme des hussards de l'armée russe de 1741-1788, 1796-1801, 1801-1825, 1826-1855 et 1855-1882. Dans le dernier article du cycle, nous parlerons de l'uniforme des hussards de l'armée restaurés sous le règne de Nicolas II. De 1882 à 1907, il n'y avait que deux régiments de hussards dans l'Empire russe, à la fois dans la garde impériale des gardes du corps, le régiment de hussards de Sa Majesté et les gardes du corps de Grodno.
 Il existe une version selon laquelle le précurseur des Lanciers était la cavalerie légère de l'armée du conquérant Gengis Khan, dont les détachements spéciaux étaient appelés oglans et étaient principalement utilisés pour la reconnaissance et le service d'avant-poste, ainsi que pour des attaques soudaines et rapides contre l'ennemi. afin de désorganiser ses rangs et de préparer une attaque contre les principales forces. Une partie importante des armes des oglans étaient des piques, décorées de girouettes. Sous le règne de l'impératrice Catherine II, il fut décidé de former un régiment qui semble contenir
Il existe une version selon laquelle le précurseur des Lanciers était la cavalerie légère de l'armée du conquérant Gengis Khan, dont les détachements spéciaux étaient appelés oglans et étaient principalement utilisés pour la reconnaissance et le service d'avant-poste, ainsi que pour des attaques soudaines et rapides contre l'ennemi. afin de désorganiser ses rangs et de préparer une attaque contre les principales forces. Une partie importante des armes des oglans étaient des piques, décorées de girouettes. Sous le règne de l'impératrice Catherine II, il fut décidé de former un régiment qui semble contenir
 L'artillerie a longtemps joué un rôle important dans l'armée de Moscou en Russie. Malgré les difficultés de transport des armes à feu dans l'éternel tout-terrain russe, l'attention principale a été accordée au moulage d'armes lourdes et de mortiers - des armes pouvant être utilisées lors du siège de forteresses. Sous Pierre Ier, quelques pas vers la réorganisation de l'artillerie furent franchis dès 1699, mais ce n'est qu'après la défaite de Narva qu'elle commença sérieusement. Les canons ont commencé à être réduits à des batteries destinées aux batailles sur le terrain, à la défense
L'artillerie a longtemps joué un rôle important dans l'armée de Moscou en Russie. Malgré les difficultés de transport des armes à feu dans l'éternel tout-terrain russe, l'attention principale a été accordée au moulage d'armes lourdes et de mortiers - des armes pouvant être utilisées lors du siège de forteresses. Sous Pierre Ier, quelques pas vers la réorganisation de l'artillerie furent franchis dès 1699, mais ce n'est qu'après la défaite de Narva qu'elle commença sérieusement. Les canons ont commencé à être réduits à des batteries destinées aux batailles sur le terrain, à la défense
 1 Don Ataman, XVIIe siècle Les Cosaques du Don du XVIIe siècle se composaient d'anciens Cosaques et de Golota. Les anciens cosaques étaient ceux qui étaient issus des familles cosaques du XVIe siècle et nés sur le Don. Golota s'appelait les Cosaques dans la première génération. Golota, qui a eu de la chance dans les batailles, s'est enrichi et est devenu de vieux cosaques. Une fourrure chère sur un chapeau, un caftan en soie, un zipun en tissu brillant d'outre-mer, un sabre et une arme à feu - un couineur ou une carabine étaient des indicateurs
1 Don Ataman, XVIIe siècle Les Cosaques du Don du XVIIe siècle se composaient d'anciens Cosaques et de Golota. Les anciens cosaques étaient ceux qui étaient issus des familles cosaques du XVIe siècle et nés sur le Don. Golota s'appelait les Cosaques dans la première génération. Golota, qui a eu de la chance dans les batailles, s'est enrichi et est devenu de vieux cosaques. Une fourrure chère sur un chapeau, un caftan en soie, un zipun en tissu brillant d'outre-mer, un sabre et une arme à feu - un couineur ou une carabine étaient des indicateurs
 Les uniformes militaires sont appelés vêtements établis par des règles ou des décrets spéciaux, dont le port est obligatoire pour toute unité militaire et pour chaque branche de l'armée. La forme symbolise la fonction de son porteur et son appartenance à l'organisation. L'expression stable honneur de l'uniforme signifie l'honneur militaire ou corporatif en général. Même dans l'armée romaine, les soldats recevaient les mêmes armes et armures. Au Moyen Âge, il était d'usage de représenter les armoiries d'une ville, d'un royaume ou d'un seigneur féodal sur des boucliers,
Les uniformes militaires sont appelés vêtements établis par des règles ou des décrets spéciaux, dont le port est obligatoire pour toute unité militaire et pour chaque branche de l'armée. La forme symbolise la fonction de son porteur et son appartenance à l'organisation. L'expression stable honneur de l'uniforme signifie l'honneur militaire ou corporatif en général. Même dans l'armée romaine, les soldats recevaient les mêmes armes et armures. Au Moyen Âge, il était d'usage de représenter les armoiries d'une ville, d'un royaume ou d'un seigneur féodal sur des boucliers,
 L'objectif du tsar russe Pierre le Grand, auquel toutes les ressources économiques et administratives de l'empire étaient subordonnées, était la création de l'armée en tant que machine d'État la plus efficace. L'armée, héritée du tsar Pierre, qui avait du mal à percevoir la science militaire de l'Europe contemporaine, peut être qualifiée d'armée avec une grande étendue, et la cavalerie y était bien moindre que dans les armées des puissances européennes. Les paroles de l'un des nobles russes de la fin du XVIIe siècle sont connues: il est dommage de regarder la cavalerie du cheval
L'objectif du tsar russe Pierre le Grand, auquel toutes les ressources économiques et administratives de l'empire étaient subordonnées, était la création de l'armée en tant que machine d'État la plus efficace. L'armée, héritée du tsar Pierre, qui avait du mal à percevoir la science militaire de l'Europe contemporaine, peut être qualifiée d'armée avec une grande étendue, et la cavalerie y était bien moindre que dans les armées des puissances européennes. Les paroles de l'un des nobles russes de la fin du XVIIe siècle sont connues: il est dommage de regarder la cavalerie du cheval
De l'auteur. Dans cet article, l'auteur ne prétend pas couvrir entièrement toutes les questions liées à l'histoire, à l'uniforme, à l'équipement et à la structure de la cavalerie de l'armée russe, mais a seulement essayé de parler brièvement des types d'uniformes en 1907-1914. Ceux qui souhaitent se familiariser plus profondément avec l'uniforme, le mode de vie, les coutumes et les traditions de la cavalerie de l'armée russe peuvent se référer aux principales sources indiquées dans la bibliographie de cet article. Dragons Au début du XXe siècle, la cavalerie russe était considérée
Le corps des topographes militaires a été créé en 1822 dans le but d'apporter un soutien topographique topographique et géodésique aux forces armées, réalisant des relevés cartographiques d'État dans l'intérêt des forces armées et de l'État dans son ensemble, sous la direction du service topographique militaire. dépôt de l'état-major général, en tant que client unique de produits cartographiques dans l'empire russe. Officier en chef du Corps des topographes militaires dans un demi-caftan de l'époque
A la toute fin du XVIIème siècle. Pierre I a décidé de réorganiser l'armée russe selon le modèle européen. La base de la future armée était les régiments Preobrazhensky et Semenovsky, qui déjà en août 1700 formaient la garde royale. L'uniforme des soldats des Fusiliers des Life Guards du régiment Preobrazhensky se composait d'un caftan, d'une camisole, d'un pantalon, de bas, de chaussures, d'une cravate, d'un chapeau et d'un epanchi. Le caftan, voir l'image ci-dessous, est fait de tissu vert foncé, jusqu'aux genoux, au lieu d'un col, il avait un tissu
Pendant la Première Guerre mondiale de 1914-1918 dans l'armée impériale russe, la tunique d'imitations arbitraires de modèles anglais et français, qui a reçu le nom général français après le général anglais John French, s'est généralisée. Les caractéristiques de conception des vestes de service consistaient principalement en la conception d'un col rabattu doux ou d'un col montant doux avec une fermeture à bouton, comme le col d'une tunique russe, une largeur de manchette réglable à l'aide de
 1 Demi-tête des archers de Moscou, XVIIe siècle Au milieu du XVIIe siècle, les archers de Moscou formaient un corps distinct au sein de l'armée streltsy. Sur le plan organisationnel, ils étaient divisés en ordres du régiment, dirigés par des colonels en chef et des demi-chefs par des lieutenants-colonels majors. Chaque ordre était divisé en centaines de compagnies, commandées par des capitaines centurions. Les officiers du chef au centurion étaient nommés par leur décret du tsar de la noblesse. Les compagnies, à leur tour, étaient divisées en deux pelotons de cinquante
1 Demi-tête des archers de Moscou, XVIIe siècle Au milieu du XVIIe siècle, les archers de Moscou formaient un corps distinct au sein de l'armée streltsy. Sur le plan organisationnel, ils étaient divisés en ordres du régiment, dirigés par des colonels en chef et des demi-chefs par des lieutenants-colonels majors. Chaque ordre était divisé en centaines de compagnies, commandées par des capitaines centurions. Les officiers du chef au centurion étaient nommés par leur décret du tsar de la noblesse. Les compagnies, à leur tour, étaient divisées en deux pelotons de cinquante
Dans la première moitié de 1700, 29 régiments d'infanterie ont été formés et, en 1724, leur nombre est passé à 46. L'uniforme des régiments d'infanterie de campagne de l'armée ne différait pas par la coupe des gardes, mais les couleurs du tissu à partir duquel les caftans étaient cousus étaient extrêmement variés. Dans certains cas, les soldats d'un même régiment étaient vêtus d'uniformes de couleurs différentes. Jusqu'en 1720, le bonnet était une coiffe très courante, voir fig. dessous. Il se composait d'une couronne cylindrique et d'une bande cousue sur
En 1711, entre autres postes, deux nouveaux postes sont apparus dans l'armée russe - l'aile adjudant et l'adjudant général. Il s'agissait de militaires particulièrement dignes de confiance, appartenant aux plus hauts chefs militaires et, à partir de 1713, à l'empereur, qui exécutait des missions responsables et contrôlait l'exécution des ordres donnés par le chef militaire. Plus tard, lorsque le tableau des grades a été créé en 1722, ces postes y ont été inclus, respectivement. Des classes ont été définies pour eux et ils ont été assimilés
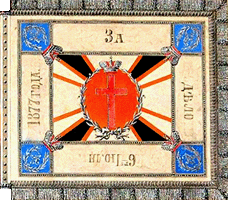 Depuis 1883, les unités cosaques ont commencé à privilégier uniquement les normes correspondant pleinement en taille et en images aux normes de cavalerie, tandis que le tissu était fabriqué selon la couleur de l'uniforme de l'armée et que la bordure était de la couleur du tissu de l'instrument. À partir du 14 mars 1891, les unités cosaques se voient accorder des bannières de taille réduite, c'est-à-dire les mêmes normes, mais sur des mâts de bannière noirs. Bannière de la 4e division cosaque du Don. Russie. 1904. L'échantillon 1904 est parfaitement compatible avec un modèle similaire de cavalerie
Depuis 1883, les unités cosaques ont commencé à privilégier uniquement les normes correspondant pleinement en taille et en images aux normes de cavalerie, tandis que le tissu était fabriqué selon la couleur de l'uniforme de l'armée et que la bordure était de la couleur du tissu de l'instrument. À partir du 14 mars 1891, les unités cosaques se voient accorder des bannières de taille réduite, c'est-à-dire les mêmes normes, mais sur des mâts de bannière noirs. Bannière de la 4e division cosaque du Don. Russie. 1904. L'échantillon 1904 est parfaitement compatible avec un modèle similaire de cavalerie



